Tentative de mise par écrit du chaos de sensations qui précèdent et accompagnent le départ, ce bouleversement dont jamais on ne fera l’économie (qui participe du processus tout entier, peut-être même de son plaisir), pour la première fois par voie électronique. À voir ce que la rapidité et la touche backspace apporteront à l’entreprise, en lieu et place de l’humble stylo sur papier raturé.
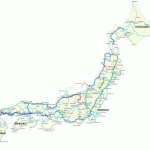
Le plus étrange est que pour la plus grande partie de la journée, depuis le réveil vers midi après un sommeil splendide et bien nécessaire après ces deux jours de traduction-relecture à bride abattue au nom de l’Art – mais aussi et surtout pour se défrayer quelque peu soi-même des montants conséquents engagés ou en passe de l’être dans les procédures administratives et autres 繁文缛节 afférents au vagabondage transfrontalier – réveil cependant très légèrement mélancolique parce que seul, dans l’ombre d’un longing bien connu ; à la surface du coeur, les traînées lacrymales encore humides – pour la plus grande partie de cette journée je me suis senti curieusement serein, détendu, content.
Peut-être était-ce une persistance cardiaque (n’y a-t-il donc que cette épithète pour parler de l’organe, malgré cette autre fonction extra-métabolique et bien connue ?) de ma visite au Dongyue Miao, enfin accomplie après plus d’un an et demi de regards quotidiens vers la rive nord de Chaoyangmen Wai Dajie en vélo au passage, en route vers l’espace du décalage, à me dire qu’« un jour, oui, un jour… » Eh bien voilà qui est fait, et je tire une satisfaction profonde de pouvoir enfin rayer cette tâche de ma liste “Things to See”. Non pas que le temple en lui-même soit particulièrement renversant : aux murs la peinture pèle, les cours sont envahies de structures hideusement rouges et plastiques à franges, photos du daozhang serrant fièrement la pince à moult éminents représentants religieux de contrées lointaines, lui plutôt gouleyant – avec plus qu’un soupçon de ventripotence – dans son bel habit bleu nuit… (Enchanteur noir, couleur du soir) Il a l’air si bien nourri, propre sur lui et mauvais acteur qu’on le dirait tout droit sorti d’une série télévisée historique chinoise. On aurait beau ne pas être au fait du triste sort qu’ont connu les lieux sur à peu près toute l’étendue du vingtième siècle (transformation en école de cadres du Parti, etc.), jusqu’à la réhabilitation de 1999, qu’on flairerait quand même l’anguille, que diantre !, la murène.
Et dans la cour finale, cette misérable estrade tout aussi criarde, infatuée de son gros écran à cristaux liquides mais fort heureusement vide, en ce jour de grisaille idéale, de l’agitation et du tapage dont on imagine sans peine l’envahissement les jours de casquettes, de petits drapeaux et de mégaphones. Les représentants d’une portion conséquente de la bureaucratie céleste qui peuplent les niches, quant à elles, sont la source de divertissements sans doute involontaires : humains à tête de poisson ou de chat, goules étendant les bras comme autant de Bela Lugosis sous amphétamines pour happer le mécréant, pécheurs tenant à pleins bras (avec une expression timide et pincée) leurs entrailles déversées – autant de statues en plâtre d’une facture des plus médiocres, barbouillées de couleurs hideuses. Dans l’ombre de chacune se dessine le sourire narquois et méprisant du bureaucrate – terrestre, celui-là – qui aura commandité leur fabrication bâclée au plus bas coût, parce qu’après tout il faut bien amuser le petit peuple avec ces reliquats de superstitions primitives.
Et pourtant, malgré toutes les infamies, malgré même les gardes oisifs et frustrés déambulant ici et là, et dont l’occupation principale consiste à gueuler des inanités le plus fort possible dans leurs talkies-walkies qui leur crachent en retour des réponses du même cru, prononcées à quelques mètres de là — ces six cent quatre-vingt seize années d’histoire ne sont pas passées en vain. Toits de tuile grise, corniches herbeuses, et jusqu’aux hautes stèles de marbre dont certaines ont résisté à l’assaut des assassins morveux à brassards rouges, sans même parler des gushu et autres shouhuai qui émergent d’entre les dalles comme les appendices faramineux de monstres enfouis, la poussière frémit encore des échos venus tout droit de la lointaine dynastie Yuan. Une époque où ce temple se trouvait au-dehors des murs de la cité, sur la grande route menant tout droit à la porte qui s’appellerait plus tard celle de Chaoyang ; de là, on pénétrait dans la Grande Capitale de Kublai Khan, Dadu.
Et surtout, il y a ce saint des saints, cette chapelle centrale gardée par un moine assoupi où se dressent dans l’obscurité presque totale les statues en bois nanmu de trois puissants dieux. “天官赐福 水官解厄 地官赦罪” proclament les inscriptions qui luisent encore faiblement dans l’ombre : « Le dieu du Ciel confère la prospérité ; le dieu de l’Eau délivre des calamités ; le dieu de la Terre absout des péchés. » C’est dans cet espace muet, coupé du monde, saturé d’encens, qu’on touche enfin à l’intemporel.
Suite de l’après-midi passée au rythme de diverses tâches cybernétiques, jusqu’à l’accélération brutale et haletante des préparatifs comme l’heure approchait avant le départ du train de nuit pour Qingdao.
(Se dire qu’on ne sait jamais, au départ du voyage, quel degré de transformations il occasionnera ; on voit défiler la ville pluvieuse derrière la vitre du taxi, et on se rassure, car finalement rien n’empêche le retour, la reprise du train-train, la familiarité ; mais on est très conscient pourtant du fait que ce moment précis, soi-même observant la ville depuis l’intérieur du taxi filant vers la gare, pourrait aussi être remémoré, depuis le point de vue d’un certain futur, comme le point de départ d’un bouleversement intégral et définitif. Moment bénin et cependant d’une portée subversive prodigieuse, radicale, effrayante. C’est peut-être ce qui fait la valeur du voyage : cette rupture à la fois immédiate et en puissance – bien qu’elle défie l’imagination et qu’on n’en perçoive par avance que l’aura distante, par une forme de pressentiment dont on espère à demi qu’il n’est pas auto-réalisant.)
10/01 Qingdao Bei
On débouche hors des entrailles de la gare dans un air crépusculaire et poisseux, au pied de gigantesques superstructures. Il faut un certain temps à l’oeil pour connecter cet exosquelette extraterrestre au bâtiment qu’il soutient, haut de dizaines de mètres comme c’est l’usage pour les nouvelles gares de gaotie, aux dimensions d’aéroports. Celui-ci doit ressembler vaguement vu du ciel à une espèce de mante (marine), pour autant qu’on puisse en juger. Le voyageur hébété par une nuit passée sans fermer l’oeil, écrasé par cette vision, est en même temps bloqué de l’autre côté par une oppressante bâche-palissade rugissante de slogans (« Faisons de la satisfaction des masses populaires notre objectif-clé ! ») et de derrière laquelle résonne aussi le tapage de marteaux-piqueurs (chose étrange, l’interstice qu’on déniche enfin – besoin d’oxygène visuel – dans ce mur ne donne à voir qu’un vaste terrain vague et herbeux. Le bruit des marteaux-piqueurs ne serait-il qu’un effet sonore destiné à persuader tout le monde qu’ici, on ne chôme pas ?)
Une chose est sûre : l’esplanade majestueuse, de la taille d’un terrain de football, qui en fin de compte s’étendra devant cette façade – comme c’est l’usage pour toute gares nouvelle qui se respecte – n’est pas encore de ce monde.
En recherche éperdue de quelque table graisseuse où m’asseoir pour manger un morceau et réfléchir à la suite des opérations, je tente de me faufiler dans la gare ; n’ayant pas de ticket valable, je suis promptement éconduit par la vérificatrice. Je lui soumets mon ingénieux plan, mais pas impressionnée outre mesure, elle me recommande d’aller voir « là-bas tout droit » (en longeant la bâche) si elle y est, « et tourner à droite. » Hélas, pas plus de riants petits établissements chaleureux au bout de la bâche qu’il n’y a de trésor au bout de l’arc-en-ciel : seulement des flaques, beaucoup de flaques, de l’air pégueux de la mer, et encore des bâches. Au bord d’un parking vide, des maisonnettes de tôle du style qu’on trouve en général au bord des autoroutes du fin fond du pays, faisant office de haltes sommaires pour routiers et passagers exténués de bus longue-distance — populations mutiques et moroses. Mais le snack Changqing n’est pas encore ouvert. Ses tôles blanches mouillées rayées de bleu se reflètent, démultipliées, dans les flaques traversées prudemment par les passants désorientés.
(Note : je sens d’ores et déjà que le transport de cette valise, en lui-même, jusqu’à destination, va constituer à lui seul une riche source de désagréments – peut-être l’élément qu’il fallait à ce voyage pour gagner la dimension épique qui lui manquait)
Bravant un vent hurlant, du genre qui force le piéton à s’arc-bouter, à réduire la surface donnant prise au souffle intraitable, traîner la valise jusqu’au Cruise Passenger Terminal, sous les regards ahuris de ceux à qui ce laowai échevelé demande son chemin.
Le lieu m’est indiqué finalement par le contremaître qui a élevé sa paume tournée vers moi de façon si sévère et même un tantinet excessive, façon exorciste, en me voyant m’approcher de lui (et donc, par conséquent, de l’entrée du vaste chantier ou entrepôt à ciel ouvert ou sont empilés des multitudes d’éléments de construction, sans doute d’une importance stratégique – mais seule l’inverse de cette relation était du domaine des possibles à ses yeux) ; malgré un regard appuyé, lourd de suspicion (la fourberie des étrangers n’étant plus à démontrer), il m’indique la direction de la Porte n°5.
L’immense hall de ce bâtiment qui est évidemment conçu pour les départs et arrivées de hordes de passagers partant en croisière est ce matin complètement vide, et passablement sombre. Sur les dalles luisantes se reflètent les slogans qui défilent continuellement sur les cristaux liquides d’un mur : « Protégeons nos montagnes et nos forêts ! » La playlist du lieu, plutôt éclectique, alterne pop anglophone, pop taïwainaise, et concertos pour piano de Rachmaninov.
Un homme m’aperçoit au loin, s’approche sur sa bicyclette à travers le hall. Vêtements simples aux manches élimées, la soixantaine, petits yeux plissés dans un visage buriné par les éléments : de toute évidence, le gardien. Je lui explique ma situation ; il me conseille de m’asseoir sur l’un des trois cent sièges à ma disposition, et d’attendre. Depuis ce poste d’observation, j’aperçois une femme se mouvoir à une extrémité de la salle, vêtue de ce genre de pyjama rose, moulant et duveteux (souvent ornés d’innocents messages à l’orthographe approximative, du style “Touch em HERE”) que bien des Chinoises affectionnent pour la conduite de leurs activités quotidiennes. Elle répond au téléphone, je la perds de vue, et elle réapparaît dans son uniforme d’officier du port, chemise blanche à épaulettes. Comme elle approche, je discerne à présent de grosses lunettes rondes qui lui donnent un air très charmant de hibou effaré.
À mon grand soulagement, elle me confirme l’existence du ferry. J’apprends que l’embarquement se fera dans l’après-midi, dans un autre bâtiment du port. Ne me reste plus qu’à patienter et cuver ma nuit blanche ici ou là. Aimablement, elle m’autorise à laisser mon pénible bagage dans une sorte de débarras, vu qu’il n’y a de consigne nulle part. Comme je repasse la Porte n°5, je croise l’homme que j’avais pris pour le gardien ; il est maintenant paré d’un splendide uniforme d’officier bleu marine, avec épaulettes et képi assorti, et il se déplace avec un air d’autorité manifeste.
Le reste de la journée est une succession de pauses et d’aller-retours peu remarquables le long d’une même droite reliant le centre passagers à une extrémité de la rue Lingxian, à quelques centaines de mètres de là, sans puis finalement avec valise. À différents degrés de progression le long de cette ligne temporelle, j’apprends d’abord que le départ du bateau est différé de deux heures en raison du vent violent, qui empêche tout accostage ; qu’il est différé encore jusqu’à une heure inconnue ; et pour finir, qu’on ne partira que le lendemain.
À l’auberge de jeunesse où je dois donc rester, au sommet de la pente menant à la rue Lingxian qu’il est bien plus plaisant de gravir sans une lourde valise, mon compagnon de dortoir me complimente sur mes origines, selon lui irréprochables. « 法国?好!浪漫之都! » D’autres pays, il ne saurait dire, mais la France, franchement bien, chapeau. Non pas qu’il s’y soit rendu, bien sûr. Ah, le vin français ! Et la langue, elle ressemble un peu à l’allemand, non ? (Dans les manuels d’utilisation de l’équipement d’embouteillage de vin dont il est installateur, il y a du texte dans ces deux langues, et il a trouvé que les mots avaient une allure plutôt similaire.)
Il est cordial et aussi chaleureux qu’on peut l’être, mais par bonheur, on fait l’impasse sur le « 你扫我,我扫你? », et on se sépare sur un sobre selfie à deux. Il me souhaite une bonne nuit, et me dit qu’il va prendre un verre. Plus tard, sa voix me parvient depuis l’espace café-bar-KTV de l’auberge, comme il entonne à pleins poumons ses classiques préférés de la pop chinoise.
Je le retrouve sur le coup d’une heure et demie du matin, après que de vagues coups étouffés à la porte de la chambre et le raclement piteux d’une clé échouant décidément à s’introduire dans la serrure aient fini par me tirer d’un sommeil profond et bienheureux. J’ouvre la porte, qui n’était d’ailleurs pas fermée à clé ; il titube dans la chambre avec un bafouillis d’excuses, et s’affale à moitié sur son sommier, où sont encore empilées toutes sortes de choses. N’étant allongé qu’à moitié, son prochain mouvement l’envoie se vautrer par terre, entre son lit superposé et un autre, et nul tapotement d’épaule, nulle injonction n’atteint sa conscience désormais profondément hors de portée. Il est par ailleurs fort pesant. Je le laisse donc s’entortiller voluptueusement autour d’un pied de lit, finissant allongé à demi sous le sommier, et passe le reste de la nuit à l’écoute de ses ronflements sonores et du bruit de ses baskets couinant sur le plancher de la chambre.
02/10
Matin de petit-déjeuner qui ne tient pas ses promesses (mais qu’espérais-tu donc, à commander bacon et toasts dans une auberge de jeunesse bon marché de Qingdao ?), puis direction le port, où l’employée de la compagnie d’Orient Ferries m’a recommandé de me présenter « avant 8h30. » Résultat, il faut attendre près de 11h avant l’embarquement.
L’attente est passée principalement à tailler la bavette avec un groupe de fiers représentants de Lianyungang, province du Jiangsu, venus accueillir le fils prodigue à son retour du Japon par le même bateau. Il y a là Jiao, chauffeur de taxis tout rond, cheveux frisés, souriant et qui paraît monté sur ressorts ; Li, plus sérieux, aimant à se donner des airs derrière de larges lunettes de soleil, et qui semble me suspecter d’être un espion à la solde de forces hostiles, du fait de ma capacité à parler chinois ; et un troisième bonhomme, cheveux ras et petits yeux humides, rapprochés et fuyants (shifty-eyed), qui semble toujours en train de mijoter quelque tour pendable. Il est « dans le porc » (搞猪的). Longues conversations sur ma vie, mes plans, la texture de mes cheveux (« tu les permanentes, ou c’est naturel ? ») et surtout émerveillement devant la qualité si biaozhun de mon putonghua. On se quitte sur des photos de groupe, échanges de numéros, et une invitation cordiale à venir déguster quelque mystérieuse spécialité locale de Lianyungang.
Rencontre aussi de Song Shenglong, 22 ans, qui a passé déjà deux années de sa vie à travailler comme pêcheur sur un bateau pour une petite compagnie japonaise à Hiroshima. L’une des personnes les plus chunpu qu’il m’ait été donné de rencontrer. Admirateur fervent de la société japonaise, son ordre, sa quiétude et sa politesse, ainsi que de l’industrie de ses membres – à l’image de sa patronne, 62 ans, qui travaille autant voire plus que les pêcheurs qu’elle emploie sur le bateau. Il me raconte ses dures journées (parfois douze à quinze heures par jour en mer), le froid en hiver, les conditions primitives de son hébergement qui font tout de même penser à de l’exploitation ; mais aussi la chance qu’il a de gagner près de 10 000 RMB par mois (env. 1400 euros) grâce à ce travail, quand il ne pourrait guère espérer que le tiers s’il restait en Chine (ses parents sont simples agriculteurs, lui-même n’est allé qu’au lycée) – ou encore la possibilité de bénéficier d’une couverture médicale intégrale, quand le système chinois ne le rembourserait pas d’un seul fen. Et par-dessus tout, au petit matin, lorsque le soleil se lève sur la mer, ni le froid ni l’exténuation ne l’empêchent de contempler la splendeur du monde qui l’entoure. Il a mis de l’argent de côté, et compte rentrer au pays pour de bon l’année prochaine, pour se marier avec son amie qui travaille quant à elle près de Tokyo.
Au passage de la douane, on me demande d’ouvrir ma valise. Je m’interroge : est-ce pour le couteau de camping qui s’y trouve ? Les feuilles de verveine séchée ? Non : il s’agit des vingt-six livres que je transporte. Découvrant que tout cela n’a pas l’air d’ouvrages de propagande impérialiste à l’usage des masses, le douanier me laisse replacer mes effets vestimentaires dans la valise énorme, que je traîne pour mes péchés.
Sur la page web de la compagnie Orient Ferries, on peut lire que le ferry Utopia a été lancé en 1980 pour célébrer le rétablissement des relations diplomatiques sino-japonaises. Le service était sans doute des plus utiles au moment de sa mise en service, mais à présent, l’Utopia est une relique surannée du passé. Nous sommes moins d’une cinquantaine de passagers à bord, pour une capacité de 350 personnes, en quasi-majorité des Chinois s’en allant travailler au Japon et qui comptent chaque sou : l’aller-retour en ferry coûte trois fois mois cher qu’un billet d’avion équivalent.
Rideaux marron style très 70s dans les cabines à lits superposés en bois qui ont vu des jours meilleurs, moquettes usées par des milliers de chaussons, et partout un léger parfum de salon de grand-mère à l’aération défectueuse. Et pour cause : tout accès au pont du navire est verrouillé une heure après le début de la traversée, et avec lui les charnières du moindre hublot. Bulle spatio-temporelle. Les horloges sont toutes arrêtées – à part celle au-dessus du comptoir d’accueil – mais chacune est figée à une heure différente : douze heures vingt-et-une dans le salon « panoramique » près des dortoirs, vers la proue, aux grands hublots cadenassés et aux trois prises électriques envahies de chargeurs à téléphones portables ; quatre heures cinquante dans le réfectoire ; neuf heures cinq dans la salle des machines à boissons…
Il est onze heures trente-six dans l’espace « lounge » au dernier étage, ouvert de huit heures à dix heures trente pour une soirée karaoké. Spectateurs assis dans les fauteuils en faux cuir, tournés vers l’écran où défilent les paroles de chansons datant de l’époque de mise en service de l’Utopia, pop sirupeuse coréano-taïwano-sino-japonaise ; derrière les sous-titres sont projetés des films de danseuses se déhanchant avec cette espèce de fougue mécanique et outrancière des Madonna et autres, sans le moindre rapport avec le contenu de la chanson en question. Les spectateurs immobiles, sirotant l’une des deux ou trois boissons disponibles, écoutent respectueusement l’interprète d’un moment, debout devant un étrange petit poste de télé cathodique monté sur pied, vieux de trente ans et qui évoque irrésistiblement quelque scène d’un film de David Lynch – et de temps à autre quelqu’un se lève discrètement pour aller choisir l’objet de son moment de gloire dans le catalogue plastifié aux milliers de titres. Applaudissements mesurés, atmosphère feutrée, ennui irrépressible. Au plafond valsent les lumières de petits projecteurs colorés façon disco.
L’espace cabine « 2e classe A », où l’on trouve des lits superposés à l’occidentale (au contraire des grands tatamis collectifs « 2e classe B »), est le lieu d’une somnolence profonde et persistante, du fait de la chaleur accompagnant sa position à tribord du navire, et du ronron des moteurs qui se transmet à travers la coque et jusqu’au bois des lits, en une remarquable imitation de halètement ferroviaire. On y succombe immédiatement à un sommeil bienheureux, dont on n’émerge avec difficulté et la tête embrumée que lorsque retentit l’appel radiophonique du repas.
Mais nul lieu n’est plus propice à la contemplation méditative de l’existence que la salle de bains collective, surtout lorsqu’on en dispose pour soi tout seul : l’eau du bassin est à la température d’un liquide amniotique, et se meut lentement en un va-et-vient suivant le roulis du bateau, et ne peut qu’évoquer le mouvement du berceau, ou peut-être celui du corps maternel sur une balançoire, entre autres scènes passablement bucoliques. On y reste suspendu aussi longtemps que possible, priant que ne survienne jamais l’irruption d’autrui dans cet Eden retrouvé.
03/10
Arrivée à Shimonoseki. Textos d’avertissement reçus de la part de mon opérateur de téléphonie mobile chinois.
« Le Bureau de Foresterie nationale vous prie de ne pas chasser, collecter ou faire usage d’animaux ou plantes sauvages, ni d’acheter, transporter ou expédier par la poste des représentants d’espèces en voie d’extinction. »
« Le Bureau de Quarantaine vous prie de ne pas transporter lors de votre passage de la frontière de fruits et légumes frais, graines et pousses, nids d’hirondelles, viandes, œufs et laitages, spécimens de laboratoire et autres produits naturels.»
« Le Bureau national du Tourisme vous prie de bien vouloir respecter lors de votre voyage à l’étranger les “Trois obligations et les Trois interdictions” : obligation de Sécurité, de Politesse, et d’Hygiène ; interdiction de parler trop fort en public, de faire des graffiti, et d’enfreindre la loi. »
Nous arrivons à 16h30, après seulement 28 h de traversée ; à se demander où le ferry passe tout son temps pendant les 38 heures que dure normalement le trajet, quand le départ n’est pas retardé.
Petit rire d’embarras irrité de l’officier d’immigration, une jeune femme à lunettes, lorsque je suis incapable de lui fournir le numéro de téléphone de mon auberge, ni un billet de voyage retour hors du pays. Petits « Oooh » de curiosité respectueuse émis par la douanière lorsqu’elle explore les contenus de la désormais légendaire valise, comme elle en extrait t-shirts et slips et chaussettes, ne fronçant pas le nez malgré un fumet plutôt rance (déjà ?).
Sortie du terminal enfin, sans autres complications, dans de grands jets de lumière dorée baignant les rues propres et silencieuses, parcourues de petits véhicules cubiques. Au-dehors, je cherche le chemin de la gare : les cartes d’orientation dans la rue sont si nombreuses que c’en est comique.
The particular rush of exaltation that goes down one’s spine as the sweet music announcing the arrival of a Shinkansen high-speed train mingles with the low, ominous roar and rumble that accompanies the smooth gliding of the beast into the station…
Arrivée de mon premier train en gare de Shimonoseki
04/10 HIROSHIMA.
Contraste déchirant entre les horreurs décrites dans le Peace Memorial, et l’atmosphère paisible, chaleureuse et détendue de la ville, si riante dans le soleil doux d’octobre.
“… And when my mother lay down to rest,
Her tears fell on my face
Leaving their patterns in the dust
A white road
A white road to Hiroshima”
Peinture réalisée par un survivant :
“Downtown Hiroshima engulfed in fire, glowing red, floating in the dark.”
(nuit du 6 août 1945)
Déception, le musée est en cours de rénovation, seule la partie consacrée aux dégâts de la bombe est accessible – contrairement aux salles traitant de la géopolitique de la bombe, et le champ historique dans lequel le lâcher s’est inscrit. Quant aux panneaux qui présentent un résumé de ces questions, à la sortie, un détail saute aux yeux : « In 1931, the Manchurian incident kindled tensions between China and Japan, and thereafter flared up into full-blown war in 1937. » (de mémoire) Dans un musée qui se veut porte-étendard de la paix entre les nations, il suffit de cette formulation répugnante de révisionnisme ou de dissimulation pour me gâcher la visite. Pourquoi admettre l’attaque du Japon contre « les États-Unis et leurs alliés », mais passer sous silence l’invasion de l’Asie tout entière – et son cortège d’atrocités ?
Dans le parc, croiser et recroiser le même groupe étendu mais dense de touristes tchèques, chenille luisante d’objectifs et de lunettes noires déjà endurée à l’intérieur du musée. Caresse pâle du soleil couchant sur le dôme d’exposition construit par un de leurs compatriotes il y a un siècle exactement, bâtiment iconique, et l’un des seuls à être resté debout comme la première bombe atomique de l’histoire détonait juste à la verticale de lui.
J’échoue à me rendre sur l’île de Miyajima et sa mythique torii, malgré deux tentatives. La faute à un manque d’informations concernant les horaires de ferries, et un planning problématique. Je ne peux donc me rendre à mon auberge.
Qu’à cela ne tienne : nuit dans un hôtel à capsules. Concept qui toucherait à la perfection (salle de bains commune propre et confortable, prix raisonnable, loquet personnel etc.) si seulement on pouvait refermer la sixième paroi du sarcophage, en lieu et place de tirer un maigre rideau qui laisse encore filtrer lumière (et ronflements) du dehors. Mesure anti-incendie ? Prévention de crises de claustrophobie nocturnes menant à la crise cardiaque ? Ou afin de pouvoir, le cas échéant, extirper plus facilement – et par les pieds s’il le faut – le dormeur impénitent, tel un bulot hors de sa coquille ?
05/10
Panne d’oreiller, je rate les sept heures de train par lignes locales qui m’auraient fait traverser derechef la chaîne de montagnes, de la côte sud à la côte nord. Je me résigne au plan B, à savoir prendre le Shinkansen jusqu’à Okayama, suivi d’un express jusqu’à Matsue. Regret de courte durée : la deuxième partie du trajet est finalement assez pastorale pour servir de remplacement à son illustre aînée, qui m’aurait fait longer le pied du mont Daisen.
Passées les zones hyper-urbanisées de la côte, infâmes, on entre dans l’arrière-pays ; les rails se plient aux ondulations d’un cours d’eau. Étroits ponts bleu vif se reflétant dans leurs rivières ; rizières qu’on dirait fluorescentes parmi les bambous ; antiques demeures de samouraïs aux toits ornés, sévères et solidement tapis à l’ombre de collines abruptes et luxuriantes, traversées par l’éclair d’un vol de héron. Ça et là, des orbes lumineux chargent les branches d’un arbre à kakis en bordure de minuscules champs, de microscopiques potagers.
On passe du côté San-yo (山陽), adret, au côté San-in (山陰), ubac – cette côte ouest du Japon, sauvage et ombrée, que je compte suivre jusqu’à Sapporo. Paradoxalement, le soleil nous attend à l’envers des montagnes.
À Matsue, dévoration en extérieur du contenu de ma bento box achetée à la gare d’Hiroshima. Moi qui croyais m’être fait rouler, je découvre avec délices qu’elle vaut chaque centime des 1200 yen qu’elle m’a coûtée : crabe, huîtres, gingembre confit, saveurs sucrées-salées-acidulées se mariant à merveille. À quand ce genre de nourriture de gare sur l’autre rive de la Mer du Japon ? Réflexion qui ne me quittera pas tout au long du trajet.
Hemanth, originaire de Chennai et professeur de chimie à l’Université de Shimane, vient me chercher à l’entrée du campus et m’emmène chez lui. La trentaine, carrure solide de grand mangeur, yeux écarquillés par défaut. Premier Couchsurfer à même de m’accueillir, sur la vingtaine des contactés.
Il me prépare un excellent dîner à la mode tamoule – gruau de lentilles jaunes au piment et petits légumes, dont on se régale en sauçant à même l’assiette, à grands renforts de roti chauffées à la poêle. Conversation assez plaisante, mais qui me semble tout à coup déboucher sur une drôle de tension ; comme si j’avais irrité mon hôte par mégarde. Ou n’est-ce que la fatigue de son récent déplacement en Australie ?
Hemanth semble le profil-type du scientifique passionné par son ouvrage : un peu timide, un peu distant parfois. Rit de sa méconnaissance en matière de musique et de cinéma, lui dont les frères aîné et cadet sont tous deux compositeurs de musique de film à Chennai – ville dont j’apprends au passage qu’elle dispose d’une industrie cinématographique au moins aussi riche et prolifique que celle de Mumbai, mais dont les films se caractérisent par des histoires plus réalistes, moins « occidentales » selon lui.
06/10
Direction Izumo, et son grand sanctuaire shintô. Pittoresque trajet en train : ligne privée, opérée par une conductrice et d’une sorte de tour-guide à veste orange vif et petit canotier noir, chargée de vanter les charmes et l’histoire de la région. À la descente du train, les deux femmes se hâtent de précéder les passagers pour se poster de part et d’autre du tourniquet de la gare et ainsi contrôler leurs billets.
Lecture de la description que fait l’écrivain gréco-irlandais Lafcadio Hearn de sa visite à Izumo dans les années 1890, lui qui fut le premier Européen à être admis dans le saint des saints (palais principal, demeure du dieu résident chez qui les déités Shintô de tout le pays se réunissent une fois l’an au mois d’octobre pour débattre de bien des choses, en particulier des mariages humains à venir). Lecture d’autant plus plaisante qu’elle se termine devant une belle sculpture de vague surmontée d’un soleil, assis sur un banc à l’ombre des pins pluricentenaires – c’est le plus ancien lieu de culte japonais, vieux d’au moins deux mille ans –, bordant le Chemin des dieux (que les mortels ne peuvent longer que de part et d’autre de l’allée centrale, laquelle est réservée aux déités) ; les aiguilles bruissent d’ineffables murmures dans le vent de cette journée magnifique. Les branches de certains arbres sont enneigées de petits papiers blancs porteurs de vœux.
D’après Hearn, la religion Shintô résistera aux ravages du temps et de la modernité parce qu’il s’agit d’un culte qui ne peut être défini avec précision par quiconque. Les bâtiments des environs sont à peu près tous en rénovation, et le bruit des groupes électrogènes se fait entendre partout ; dans un coin, une scène est en train d’être montée pour quelque spectacle, bâches et projecteurs et centaines de chaises métalliques sur la pelouse. Mais rien de tout cela ne semble troubler les fidèles venus prier devant l’entrée, et se prendre en photo au côté des étranges statues de petits lapins blancs peuplant les alentours, dignes d’un parc d’attraction – on m’apprend qu’ils symbolisent le lapin secouru par le dieu Daikoku dont c’est ici la maison, qui offrit au rongeur une nouvelle peau après que ce dernier eût été écorché vif par le requin qu’il dupa.
Location de vélo pour aller visiter un phare. La jeune caissière ouvre de grands yeux quand je lui annonce ma destination : « C’est un peu loin, vous savez… » Mais je lui réplique un « Daijoubu desu » nonchalant, et je prends la route.
Les dix kilomètres sont en effet rudes, et je bénis l’assistance électrique du vélo plus qu’à mon tour. Mais plaisir intense de cette liberté soudaine, le long de ce splendide paysage côtier regorgeant d’îlots célèbres, à l’image de celui dont la beauté si changeante au cours de la journée poussa un peintre fameux, dépité de ne pouvoir lui rendre justice, à jeter de rage son pinceau dans la baie.
Mais la destination plus que tout justifie le déplacement – tout particulièrement pour l’amateur de phares que je suis. Seul regret : ne pouvoir m’y attarder plus longtemps, le temps par exemple de prendre un café entre deux bicoques servant du poulpe grillé. Dans une cabine téléphonique antique, un téléphone semble plaider pour qu’on l’utilise.
Retour dans le petit train inondé de soleil, qui sied à merveille au costume de la présentatrice.
07/10
Adachi Museum of Art.
Est-ce l’harmonie parfaite entre les arêtes des rochers, les lignes sombres des arbres, les courbes des buissons taillées, la pâleur uniforme et liquide des gravillons, le ciel et les collines distantes ?
Est-ce la perfection ?
Le temps investi ?
Le mouvement du vent dans les feuilles ?
Le surhumain ?
L’éphémère ?
La poursuite infatigable, la persistance ?
Les oiseaux qui, seuls, font de cette oeuvre leur paradis ?
Saisi, interdit, rivé au sol, je me perds dans cette contemplation, transi comme jamais devant un jardin. Pour les oeuvres d’art en intérieur, une autre visite : le train n’attend pas.
(allez, un instant de bathos tout de même : la statue en bronze du fondateur du musée, businessman et jardinier émérite, impériale sous une branche de pin ; et le panneau à ses côtés proclamant avec une fierté sans commune mesure que le jardin a été élu « Le Plus Beau Jardin du Japon, pendant douze années consécutives, par le magazine Japanese Gardens. » Il fait bon être un magazine en ces contrées.)
Yonago-Tottori.
La mer à notre gauche (métallique, indigo), les montagnes à notre droite (azur pâle) ; elles se mirent à l’occasion dans un lac de mica.
Le soleil, par-dessus tout.
Maisonnettes et petites stations en bois somnolentes, où le contrôleur est souvent la seule personne en vue, exception faite de quelque passager immobile et serein à un arrêt de bus. À l’entrée de la station, couché dans une flaque de lumière, un chat qui en a vu d’autres observe le train d’un oeil vague. On le sent sur le point de renoncer définitivement à s’expliquer cette apparition.
Le train au départ de Tottori
Tottori-Hamasaka.
Tunnels – de terre et de vert. Le train uniwagon (wanman) se fraye tant bien que mal un passage au travers des lianes, buissons et autres avatars de forêt extravagante, ses rails comme une paire de lames, pour desservir des villages perdus aux allures d’avant-postes côtiers. Dans le wagon presque vide, trois collégiennes en uniformes et à couettes rêvassent, debout dans l’allée, accrochées aux poignées, se balançant avec grâce et une sorte de lassitude mélancolique dans les ballottements de la machine.
Ici les gares sont de métal blanc et rouillé, peinture pelée révélant squelettes bruns. Aux alentours, zones défensives au-devant des collines luxuriantes, le feu pâle des rizières.
Village d’Ine.
Arrivée très nocturne. Il n’est que 20h, mais la nuit est épaisse comme du goudron, et dans les parages on se couche si tôt qu’il pourrait aussi bien être 2h du matin. Dans le bus, un tournant soudain manque causer un homicide involontaire, comme ma valise (dépitée de ne pas s’être faite remarquer depuis trop longtemps) va presque écraser l’un des lycéens harassés peuplant le véhicule, tout de noir vêtus, piquant du nez – qui sur son téléphone mobile, qui sur son cartable.
Alex a déjà l’haleine lourdement alcoolisée quand il vient me chercher à la descente du bus. Mes contributions de junk food, malgré le bras qu’elles m’ont coûté à l’unique konbinionsu stooa encore ouvert à Amanohashidate, font pauvre figure à côté des sashimi de poulpe et autres grillades de poisson au brasero qui m’attendent dans la funaya (« maison-bateau ») de Gôdô, où je loge.
Drôle de bonhomme, ce Gôdô (aucun rapport avec Beckett) : importateur japonais de thé taiwanais taciturne, mais dont j’apprends tout à coup qu’il a rencontré Allen Ginsberg un jour – qu’il a même passé une nuit avec lui dans une même chambre – voire, dans un même lit, « …but I’m not gay so (il se mime tapotant une tête présumément fort chevelue) I just said ‘There, there, sleep.’ » Rencontre fortuite à l’occasion de la présence du grand poète à Kyoto pour une lecture publique, en 1995.
Nec plus ultra du petit salon de beuverie au bord de l’eau : la possibilité de pisser for virilement dans la mer depuis le salon de thé, ce dont Alex fait grand cas.
Lui est un mélange intéressant d’ouverture un peu superficielle sur le monde, et de conservatisme très japonais. Il aime à évoquer les deux ou trois années qu’il a passé, étant jeune, aux États-Unis et au Mexique ; il est nostalgique des filles de Cancún (sic), et de la pop californienne des années 80 (bien qu’il ne puisse citer aucun groupe favori en particulier). Son espagnol bat de l’aile, mais il garde un niveau d’anglais très acceptable – sans doute en partie du fait de la carrière qui l’a amené à devenir Directeur des ventes internationales au sein de la grande compagnie de vêtements de sport Mizuno. Malgré tout, à table, il demande à son épouse de me servir le saké (au lieu de le faire lui-même). Et quand la conversation vient à rouler sur le sujet de la pêche à la baleine, il ne cache pas son plein soutien à cette industrie, non sans un sourire indulgent envers nos préoccupations d’Occidentaux si facilement scandalisés.
Reste que sa décision de quitter la grande entreprise pour venir s’installer avec son épouse à Ine, loin de tout, est assez remarquable dans un contexte nippon. Il me dit avoir passé en revue près de vingt sites différents en bord de mer, dans tout le pays, avant de jeter son dévolu sur le village des funaya, où il a décidé de s’établir comme pêcheur. Pour des questions de licences de pêche, transmises de père en fils au Japon et peu accessibles aux nouveaux venus, il doit se contenter pour le moment de tenir un petit restaurant où il ne sert que deux ou trois plats, principalement à base d’abalone et de concombre de mer frais achetés sur le marché (sans oublier le menu spécial « baleine » bien sûr). Mais il a bon espoir de gagner le droit parvenir à réaliser son vieux rêve de piloter un jour son propre bateau pour aller à la pêche lui-même d’ici quelques mois.
C’est ce bond audacieux hors du monde des salarymen qui lui a valu (et continue de lui valoir, selon lui) l’attention de nombreux médias japonais – il expose fièrement les journaux parlant de lui au-devant de son comptoir.
En attendant d’entamer sa carrière de pêcheur, il a décidé de se faire le héraut de la culture locale. Il faut dire qu’il est l’un des deux ou trois habitants du cru à parler un tant soit peu anglais ; ainsi quand les dames de la boutique de saké échouent à me présenter comme elles le voudraient les principales attractions des environs, très rapidement le nom de Takashima Nagisa surgit – lui cet ambassadeur d’Ine auprès du reste du monde, qui en a fait la raison principale de son inscription au réseau Couchsurfing.
08/10
Balade agréable dans les rues emmatinées, sur l’un des vélos que le village (« Septième position au Classement des Plus Beaux Villages Japonais » comme le proclame un panneau) offre gratuitement à l’usage des visiteurs. Soleil, bateaux, cormorans dignement – et si flegmatiquement – dressés, qui sur un toit, qui sur une proue, presque à portée de bras.
Soudain, sur une pente à l’orée des bois, une toute petite cage – trop petite pour le jeune sanglier qui se démène à l’intérieur, groin ensanglanté par les barreaux de métal. On me montre la cage encore plus étriquée dans lequel l’animal était enfermé il y a quelques semaines. Quand j’en parle à Alex, son regard s’illumine : « Oui, le sanglier on en attrape quelquefois, c’est une viande excellente ! »
D’après lui, les bois sont aussi peuplés de petits ours bruns et de singes. Mais de ceux-là, non, on ne mange pas.
Depuis Amanohashidate (« Pont du Ciel, » en référence à une longue langue de sable saturée de pins, censée être l’un des “Trois Paysages Remarquables” du pays) il faut bien quatre heures et demi de train pour rejoindre Kanazawa en longeant la côte, et trois changements. Deux d’entre eux semblent avoir été conçus spécialement pour qu’un voyageur traînant une lourde valise ait tout juste le temps de se déplacer d’un quai vers l’autre en empruntant les ascenseurs pour bondir dans le train juste avant le départ ; si ledit voyageur traîne d’une seule seconde en route, c’en est fait de lui.
Côte très urbanisée et peu attrayante de la ligne Obama, aboutissant à la ville du même nom. Aucune trace d’auto-dérision ou de célébration de ce nom de la part des joyeux drilles du cru n’est visible, depuis la station du moins.
Devant chacune des deux sorties de la gare de Kanazawa se dresse une sculpture monumentale, mais évocatrice. L’architecture de la gare tout entière est un modèle d’élégance et de fonctionnalité, malgré sa taille relativement grande ; elle en remontre au mastodonte impraticable de Qingdao.
Shota et moi finissons par nous rencontrer, malgré maints atermoiements cybernétiques. Il ne répond à ses messages Couchsurfing qu’avec une certaine lenteur, qu’on prendrait pour de l’hésitation, et au téléphone, sa voix paraît très fluette. Je crains de tomber sur un pied-tendre pas encore sorti de l’adolescence, irascible et négligent. Heureusement ce n’est pas le cas. Son appartement est dans un état de chaos certain, mais c’est sans doute bon signe chez un Japonais. Et si le doute persiste quant à son intérêt pour la gent féminine, nulle avance à repousser.
Délassement exemplaire dans son établissement de onsen préféré, remède idéal à une demi-journée de train.
09/10
Nuit courte, très courte. Pour des raisons qui ne tiennent qu’à lui, Shota utilise trois réveils, avec trois sonneries différentes : le premier sonne à 6h, le deuxième à 7h15, le troisième à 7h30. Nouvelle nuit sans assez de sommeil.
(« Le travail commence à 8h45, » me dit-il ; sans expliquer pourquoi, dans ce cas, il doit être à son bureau dès 8h15, surtout quand sa journée de travail se termine à 22h tous les soirs. Mystères du Japon.)
Quant à moi, sommeil ou pas, guère d’autre option que de commencer ma journée au café Arco de la gare, desservi énergiquement par une serveuse qui semble se nourrir exclusivement de doses massives et quotidiennes de cocaïne.
Quelques heures plus tard, direction le bureau de Korean Air, situé à deux pas de la gare. Je ne suis pas arrivé à Sapporo qu’il me faut déjà acheter mon billet de départ, et l’Internet me joue des tours. C’est là, dans ce bâtiment, que se produit un épisode tout à fait marquant de ce voyage. L’accès au bureau de la compagnie aérienne est fermé par une porte vitrée ; au mur, près de la porte, plusieurs réceptacles à cartes magnétiques et même à empreintes digitales. Et aucun interphone permettant de contacter tel ou tel bureau sans franchir la porte.
Je cherche un gardien ; en vain. Appelle le service clients. On me confirme que le bureau est ouvert au public et assure un service de billetterie. J’y retourne : impossible d’entrer. Tente de rappeler le service clients, tâchant d’obtenir le bureau directement ; peine perdue.
En désespoir de cause, mes yeux bouffis et moi retournons à la gare, où nous échouons à obtenir de l’aide de la part du service d’informations touristiques, et en obtenons par la grâce d’une agence de tourisme avoisinante. Le prix, cependant, est près de 20% plus cher que le prix escompté. J’en viens à demander à l’agent si elle parvient à rentrer en contact avec le bureau de Korean Air : oui, tout à fait. J’hésite ; mais tant pis pour la politesse, j’en aurai le coeur net. M’excuse, retourne au bâtiment, me retrouve à nouveau devant la porte vitrée. Je la pousse. Elle s’ouvre.
La vente en direct du ticket m’assure un prix encore plus avantageux que je l’imaginais.
D’où ce questionnement : combien d’autres portes encore ai-je ainsi hésité ou renoncé à pousser, vaincu par les signes annonciateurs d’une défaite annoncée, inévitable ?
L’après-midi est déjà bien avancé comme je trouve enfin le temps de parcourir certains lieux emblématiques de cette belle ville, dont je ne verrai que peu de choses. Le parc où se trouvait autrefois la demeure immense des richissimes seigneurs du riz, forteresse qui brûla tout entière il y a deux cent ans pour ne jamais être reconstruite ; puis le jardin des « Six Harmonies, » supposément l’un des « Trois Plus Beaux Jardins du Japon » (selon quel magazine ?) et par conséquent, l’un des plus fréquentés – mais pour moi la lumière est grise et terne ce jour-là, et les allées du jardin sont fatiguées de gens, et mes yeux voilés de fatigue.
Regain d’énergie tout de même à découvrir le splendide Musée du 21e Siècle, admirable par son architecture comme par son organisation et les oeuvres qu’il renferme – parmi elles, noms à retenir : Lee Bul (sculptures fantasmagoriques et croquis de monstres), Anish Kapoor et son Origine du monde pince-sans-rire, le projet ALMA et ses disques de boîtes à musique créés à partir de la spirale de particules d’une lointaine galaxie mourante, Jananne Al-Ani et ses photos en ultra-haute définition du désert irakien, Pedro Reyes et son People’s United Nations (sculpture-horloge battant la mesure sur des fragments d’AK-47…), et Alfredo et Isabel Aquilizan (bateaux suspendus, Another Country).
Audio: un extrait du son d’une boîte à musique conçue dans le cadre du ALMA Music Box Project.
Visite seulement troublée par la conscience du rhume qui va s’amplifiant.
Nuit transpireuse sur un lit superposé d’auberge de jeunesse, sommeil troublé par d’autres occupants puis par le soleil, qui filtre bien entendu entre les rideaux risiblement facultatifs qu’on trouve de toutes parts dans ce pays.
10/10
(Tiens, il reste moins d’un mois.)
Le trajet pour Sado-ga-Shima se passe sans encombre particulière, Shinkansen doux et rapide puis ferry depuis Naoetsu – si ce n’est cette proverbiale idiotie qui me pousse à marcher depuis la gare jusqu’au port, traînant armes et bagages, ce qui s’avère un exercice ridiculement fatigant au vu de la distance, du manque d’intérêt de cette bourgade déprimante et surtout de la disponibilité (qui en douterait ?) de bus rapides et fréquents sur ce même trajet.
Rencontre à Ogi de Fumie et de son mari Shintaro. Ils me font visiter leur village favori, Shukunegi, dont je comprends peu à peu qu’il est l’une des attractions principales de l’île. Compréhensible, étant donné ses maisons de pêcheurs et d’armateurs aux architectures bien particulières – ainsi cette fameuse bâtisse construite comme un bateau, devant laquelle « il est d’usage de se prendre en photo. » Mais en ce mois d’octobre, trop peu de gens vivent ici pour accueillir comme il se doit, avec victuailles et saké, les batteurs de tambour prenant part à la Fête des récoltes qui se tient ce week-end.
Mes guides ne sont avares ni de leur temps ni de leur savoir, et me conduisent ensuite au rendez-vous avec le père supérieur Shoukei Kusaka, responsable du temple bouddhiste shingon où je vais passer la nuit.
L’email que j’ai reçu de lui précisant les conditions de mon séjour est pour le moins lapidaire :
“Thank you for contacting us.
Room are vacant.
Rates per person per night 3000 yen.
No meal.
There are no shops within 2 km.
Elevation 160m.
Recently, it has became cold in the morning and evening.
Please have careful.”
Autant dire que je suis surpris de rencontrer un homme communicatif, jovial et bedonnant ; marié et père de trois fils, d’allure prospère, son regard est plein d’une sagacité amusée. Il parle un anglais hésitant mais le courant passe. Il n’est pas six heures du soir mais la nuit est déjà noire. La voiture parcourt une route en lacets gravissant une colline très boisée, et je comprends mieux pourquoi Shoukei a préféré ne pas me laisser prendre le même chemin à pied avec ma valise depuis le hameau voisin. Enfin les contours d’un pavillon où est suspendue une énorme cloche de bronze se dessinent dans l’obscurité.
Quand nous poussons la porte d’entrée, nous sommes accueillis par le son du piano joué par une jeune fille : elle vient suivre des cours auprès de la mère de Shoukei, une vieille dame tout à fait adorable et attentionnée qui a été professeur de musique à l’université. L’épouse, quant à elle, a pris le ferry ce soir-là pour se rendre à un concert de musique classique sur le continent. Dans le salon, étagères où trônent plusieurs centaines de CD.
Alerté par l’email de Shoukei, j’ai fait escale dans une supérette avant de venir, et suis venu muni d’une bento box, d’un pot de yaourts et autres provisions d’urgence plastifiées. Mais la mère de Shoukei est aux fourneaux, et mes hôtes m’invitent donc à « goûter un petit peu » de sa cuisine. Résultat, alors que je n’ai encore dévoré que la moitié de ma bento, je me vois servi une grande platée de spaghetti bolognaise maison, avec parmesan râpé à la main.
Comme Shoukei doit emmener le petit Tatsuya (10 ans) en voiture à son cours de kendo, il propose aimablement de me laisser à une petite onsen sur le chemin, offre impossible à refuser. Une heure de bains plus tard, Mme Kusaka vient me chercher, comme elle conduit le fils cadet Keisuke (17 ans) à la maison après ses cours au lycée.
Pour finir la soirée, Shoukei m’invite gentiment à déguster une ou deux coupes de l’excellent saké produit dans différentes parties de l’île.
J’apprends qu’il a grandi et passé la moitié de sa vie dans de grandes villes du pays et fait des études d’architecture avant de venir s’occuper du Kouninji, ce petit temple blotti au creux des collines boisées, saupoudrées d’arbres à kakis, du sud de Sado. Je comprends peu à peu qu’il s’agit sans doute davantage d’un devoir filial auquel il est difficile de se soustraire que des suites d’une illumination personnelle : dans le temple principal, Tatsuya me montre les portraits de la lignée des gens qui se sont succédés ici – le père, le grand-père et l’arrière-grand-père de son propre père. Le fils aîné de Shoukei séjourne lui-même en ce moment dans le temple de Kyoto où Shoukei a lui aussi perfectionné son apprentissage.
Ma chambre est spartiate mais bien sûr propre et confortable. Le silence de la nuit n’est troublé que par le choeur d’une multitude de grillons dans les arbres aux feuilles qui roussissent déjà. L’air est frais. Finie, la verte rutilance des forêts du sud : me voici dans le nord, et dans l’automne.
11/10
Au petit déjeuner, qu’on m’offre (comme si cela allait de soi), Shoukei évoque sa soeur, partie vivre à Paris pour offrir une « meilleure » éducation à ses enfants qu’au Japon ; il est pour sa part très sceptique sur le bien-fondé de cette décision, et je partage ses doutes – bien que pour des raisons sans doute différentes. Il n’est pas encore allé lui rendre visite, bien qu’il ait déjà voyagé en Italie, aux États-unis et dans bien d’autres endroits. Sa mère, si, et de me montrer les photos attendrissantes de sa première escapade en France il y a quelques mois, en compagnie d’une amie et de leurs chiens respectifs. (Son mari est décédé il y a dix ans, année en laquelle Shoukei a décidé d’abandonner sa carrière d’architecte et d’entrer dans les ordres).
Comme on vient à parler de musique, j’apprends que Keisuke, le fils cadet, joue du trombone, du saxophone et du piano. Peu après, comme je lui pose la question, le petit Tatsuya s’assoit au piano et me joue sans hésiter une fugue de Bach.
Faisant fi de mes protestations, la mère de Shoukei insiste pour me conduire de nouveau à Shukunegi, car je suis arrivé un peu tard pour assister au festival le jour d’avant. Comment dire non ? Puis, après le déjeuner, Shoukei lui-même refuse de me laisser prendre le bus, et après avoir assuré le service religieux à un enterrement, il me conduit jusqu’à Niibo, à 50 minutes de chez lui. Un autre festival se déroule là, mais peu d’intérêt autre que les stands de snacks en touts genres ; par ailleurs le vent forcit et il souffle un air de typhon, qui me pousse à regagner bien vite ma petite chambre à l’auberge de jeunesse.
Ce soir-là, bien que j’aie opté pour le tarif « petit déjeuner uniquement », et fait des provisions auprès des stands du festival en conséquence, la patronne de l’auberge m’offre le dîner avec une chaleureuse simplicité.
12/10
La patronne me conduit au port de Ryoetsu, bien qu’un bus ait pu faire de même, et m’offre des haricots à grignoter pour la route.
Dans le ferry, je parviens à m’assoupir, bercé par les vagues et allongé sur le grand tatami collectif de la seconde classe.
(un moment de lassitude ; l’impression d’aller trop vite. Cette valise commence à me peser sur le système. MAIS : Sans doute est-il normal, et même nécessaire, qu’au cours de tout voyage au long cours un tant soit peu ambitieux ou du moins respectable, survienne un point auquel on commence à se projeter dans le futur, un futur douillet fait de nuits de sommeil réparateur, un futur sans lourdes et encombrantes valises, sans repas sur le pouce ni persistantes inquiétudes financières. Survient alors la tentation d’abréger, de raccourcir, d’avorter. Mais cède-t-on à cette tentation que le restant du voyage inachevé nous poursuivra, comme une démangeaison sur un membre amputé. C’est à ce moment-là qu’il faut se rappeler l’intention d’origine, et continuer.)
Haguro-san.
Avec une sorte d’impériosité, la montagne s’impose tout à coup à la vue, occultant tout le reste, bien que moins de dix minutes plus tôt on ait encore été au milieu d’une sorte de banale lèpre urbaine. Mais voilà, le bus prend un tournant, et plonge dans le sein de la montagne. Déprimantes un instant auparavant, la brume et la grisaille s’accordent maintenant à merveille avec la foisonnante forêt de pins et les mystérieuses torii qui enjambent ici et là cette petite route en lacets.
Quand donc guérirai-je de cet optimisme injustifié, ce 侥幸心理 qui encore et toujours me joue des tours ? Peut-il en être autrement ? N’est-il pas temps d’écouter cette petite voix quand elle tente humblement de soulever l’hypothèse d’une situation déplaisante ?
Ainsi dans le bus de ce soir depuis Tsuruoka. Pour une raison qui m’échappe, je crois être au fait de la station à laquelle je dois descendre ; lorsque le chauffeur effectue une pause prolongée au niveau de la station qui précède celle que j’ai en tête, j’ignore superbement son regard insistant dans le rétroviseur – au lieu de faire ce que la petite voix suggérait, à savoir me précipiter vers l’avant du bus et demander confirmation quant à la localisation précise de mon auberge-temple shintô. Résultat, j’arrive près d’une heure plus tard, ayant dû attendre que ce même bus effectue son trajet retour depuis le sommet.
De même, plus tôt ce soir, comme j’attendais pendant plus d’une heure le bus pour Haguro manqué de quelques minutes à Tsuruoka, il me semble bien avoir considéré vaguement l’éventualité d’un manque d’options restauratives au shukubo (temple-auberge) Kanbayashi, étant donné ma décision de ne pas demander le tarif « demi-pension » (dédoublant le prix de la nuitée). Pourtant, au lieu de me précipiter sur l’épicerie de la gare, j’ai haussé les épaules. D’où mon face-à-face imminent avec cette boîte de cup noodles, généreusement offerte par la maîtresse de maison, comme seul dîner de ce soir.
Gâté par la Chine ? Par l’hospitalité de mes hôtes de Sado ? Perturbé par le manque de sommeil ? Ou tout simplement par une confiance déraisonnable en mes capacités de voyageur débrouillard, « connaisseur » illusoire du pays et de ses kanji ?
Au moins cette chambre est-elle confortable, dans le style tatami spartiate. Au-dehors, le chuchotement constant d’une cascade dans les tréfonds de la forêt.
13/10
C’est dire la gravité du mal : alors même que j’écrivais ces lignes, hier soir, je commettais sans le savoir l’exact même genre de bourde sur laquelle je philosophais. Venant me souhaiter bonne nuit, la patronne m’a dit quelque chose se terminant par les mots « … くじ. » Comme je ne comprenais pas, elle a complété : “Nine thirty.” J’ai alors compris qu’il s’agissait de l’heure de check-out, et mis la différence constatée entre l’original japonais (« neuf heures ») et sa traduction anglaise au compte de ma compréhension limitée de la langue nippone.
Mais quand à neuf heures trente je sors de ma chambre à tatami, tout guilleret et l’énorme valise à la main – le temple semble vidé de tous ses habitants et locataires. Une télévision claironne dans la pièce d’où s’est extrait le vieux M. Kanbayashi-san la soirée précédente, à mon arrivée, mais cette fois personne ne répond à mes appels insistants. D’un bout à l’autre du bâtiment, pas un chat. Or, je n’ai pas encore réglé, et laisser l’argent sur la table serait sûrement une impardonnable faute d’étiquette, du style qui pousse tout un chacun au suicide rituel. Je n’ai donc plus qu’à attendre, et à me maudire pour ne pas avoir demandé confirmation sur la traduction de la veille. (Je découvre un peu tard, au bas d’une feuille laissée en évidence sur la table à thé de la chambre, qu’il est bien fait mention de “Nine o’clock”)
Près d’une demi-heure plus tard, la maîtresse de maison apparaît enfin ; elle ne semble pas particulièrement surprise ni désolée de me voir attendre sur les marches du salon avec mon barda. Mais qu’elle m’ait laissé mijoter dans mon jus pour me donner une bonne leçon, ou qu’elle soit simplement allée vaquer à quelque affaire pressante, après tout je suis en tort.
Au-dehors, la pluie est battante. J’ai tout de même la ferme intention de faire l’ascension du premier sommet sur la célèbre route des pèlerins yamabushi (« Ceux qui dorment dans les montagnes »), adeptes de la religion shinto-tao-bouddhiste ésotérique du Shugendo – connue entre autre pour son credo selon lequel tout adepte peut devenir un bouddha de son vivant, s’il se soumet à un régime ascétique particulièrement rigoureux, se concluant par un enterrement de son vivant – et si tout se passe bien, une auto-momification naturelle une fois la mort venue, du fait des aliments très spécifiques absorbés pendant les dernières décennies de sa vie : noix, graines, et surtout une forme de laque (!) pour empêcher le pourrissement des viscères. Deux de ces momies sont visibles dans des temples de l’autre côté de la montagne.
Haguro-san, au pied duquel se situe le village dans lequel j’ai passé la nuit, est le premier sommet que doit grimper le pèlerin ; il compte 2446 marches, sur une distance de 1,7 km. Malheureusement, l’hiver arrive si vite dans cette région montagneuse que l’ascension des deux autres sommets (Gassan et Yudono-san) est déjà fermée au public. Mais pas question de repartir sans avoir au moins vu le premier pôle de la trinité.
Le directeur du musée voisin accepte très aimablement de veiller sur ma valise le temps que je revienne. Mais les bus sont rares en cette saison, et je voudrais ne pas faire trop attendre les gens du musée ; pour être de retour dans une heure et quart, il me faut attraper le bus qui repart du sommet dans 40 minutes. Selon les guides, l’ascension s’effectue en une heure environ, mais je ris : une heure, pour marcher moins de deux kilomètres ? Vous plaisantez.
J’arrive au sommet 40 minutes plus tard, mais il me manque cinq minutes de plus pour rejoindre le point de départ du bus. Cascades, pagode millénaire à cinq étages, stèle de Basho, les marches glissantes et usées par les âges à l’ombre des cèdres immenses, et finalement le sanctuaire lui-même et ses fumées d’encens, ses dragons de bois délicatement sculptés – tout cela vu en passant et parcouru au pas de course sous la pluie. Les esprits des lieux ont dû bien rire dans leur céleste manche.
Mais le directeur du musée, bien entendu, est toujours là quand je finis par revenir – et il me recommande même un petit restaurant où je déguste de succulentes Haguro udon locales : soupe de nouilles aux champignons frais. Au-dehors, averses soudaines et vent hurlant.
Le patron de l’auberge Naniwa, à Akita, parle un peu français. Étrange visage qui semble toujours choqué par quelque nouvelle impromptue et dévastatrice, il sourit peu et timidement. Dès mon arrivée, il m’offre en cadeau un petit coaster hexagonal en matériaux de tatami. Son hôtel est un nid douillet doté d’une excellente salle de bains – baignoire en hinoki (bois de cyprès) – où tout semble fait pour veiller sur la santé des occupants : multitude de fiches-conseils dans les toilettes, les couloirs. Désinfectant pour les mains ici et là. Sur l’oreiller de mon futon, une notice présentant les mérites prophylactiques de l’oreiller en question, modèle breveté qui s’est vu décerner des certificats d’excellence de la part de plusieurs organismes internationaux.
Comme je lui demande s’il peut me conseiller un endroit où déguster quelques spécialités locales, le patron m’emmène derechef dans son 4×4 jusqu’à son adresse favorite – où il me laisse, non sans m’avoir aidé à commander. J’ai le restaurant pour moi. La maîtresse de maison me sert un délicieux kiritanpo, ragoût fameux à base de gâteaux de riz, de poulet, champignons, pousses de bambous et autres joyeusetés. Et elle me parle de choses et d’autres, de la mer, de la neige à Sapporo… je ne saisis presque rien, mais ça ne semble pas la déranger outre mesure.
14/10
Je répugne à quitter cette côte ouest boisée, rocheuse, et battue par le vent. Au lieu de couper à travers champs jusqu’à Aomori, je décide de passer le plus clair de cette journée sur le train qui suit la côte jusqu’à Goshogawara, avant de redescendre vers Hirosaki. C’est la ligne JR Gono. Aucun de mes guides de voyage n’y fait référence, mais j’aime sa position sur la carte. L’occasion de fainéanter une demi-journée à bord d’un train japonais.
Dès la deuxième station, je réalise à quel point ce train est spécial : le très ample espace pour les jambes dont profite chaque passager permet la rotation des sièges, comme le train change à plusieurs reprises le sens de sa marche. Mieux encore, il ralentit sa course quand nous arrivons aux endroits les plus spectaculaires de cette côte, qui s’avère tout à fait splendide.
C’est alors qu’on me conseille de jeter un oeil aux brochures en libre accès à l’avant du train. Il apparaît que cette ligne est bel et bien spécialement conçue pour faire découvrir aux voyageurs les charmes de cette région : la brochure détaille les différents parcs naturels, forêts antédiluviennes, musées ou monuments qu’on peut découvrir à chaque station. Certains arrêts sont prolongés pour laisser le temps d’apprécier les alentours – ainsi à Senjojiki, où le train nous donne vingt minutes pour descendre nous promener au bord de la mer, sur les roches magmatiques aux formes tourmentées qui ont surgi des les eaux lors d’un tremblement de terre, il y a quelques siècles.
D’autres activités plus folkloriques viennent aussi agrémenter ce voyage de cinq heures. Nous profitons notamment d’un concert de shamisen (une sorte de luth à trois cordes, frappé assez vivement à l’aide d’un grand plectre en ivoire) assuré par un couple de musiciens qui viennent s’assoir à l’avant du train, juste derrière la cabine du conducteur ; ils sont d’une virtuosité à couper le souffle malgré les cahots du train, qui leur font manquer une note ici ou là. Une demi-heure plus tard, ils nous saluent et quittent le wagon avec leurs instruments. Pendant ce temps, le volcan sacré Iwaki-san, que notre train a contourné toute la journée, surgit des brumes dans la lumière du crépuscule, au-delà des champs de pommiers qui s’étendent à perte de vue.
C’est un trajet qui semble conçu spécialement pour les amoureux du train. Ou pour rappeler à tout un chacun les vertus de voyager vers ces endroits dont on aime la position sur une carte.
À Hirosaki, le patron de la vieille ryokan (auberge traditionnelle) dans laquelle je loge, une auberge familiale qui a près de 150 ans d’âge, parle encore mieux français que celui d’Akita. Dès mon arrivée, il propose de me conduire à un restaurant où je pourrai déguster des spécialités locales. Serait-ce l’usage en cette région ?
Ce restaurant-ci est cependant plus haut-de-gamme que celui d’hier : les serveuses sont habillées en kimonos, et se chargent de divertir personnellement les clients assis au bar – hommes seuls ou businessmen dans leur uniforme standard, de qui elles acceptent volontiers un verre de bière ou de saké. L’une d’entre elles tente son numéro de charme sur moi, mais notre conversation est pour le moins limitée.
Me rejoignent bientôt un couple d’autres clients français, eux aussi amenés par M. Ishiba, dont on soupçonne qu’il a quelque accord avec l’établissement. Comme moi, ils tâtent du plateau de sashimi, ainsi que d’un bout de baleine.
Le dîner terminé, l’inénarrable M. Ishiba n’en a pas encore fini avec nous, puisqu’il nous invite encore à goûter d’un alcool de pomme au Member’s Bar à côté de son auberge. Endroit minuscule où on ne rentre qu’avec une carte magnétique, et dans lequel peuvent s’asseoir cinq ou six clients tout au plus. Le patron est un sexagénaire à bretelles et cheveux gominés qui nous présente avec un sourire libidineux sa collection de photos pornographiques au mur, et la petite salle attenante qui est entièrement dévouée à son culte de Marylin Monroe : les murs et étagères sont pleins de photos de la star en postures plus ou moins dénudées, incluant un croquis original d’Andy Warhol lui-même.
L’alcool de pomme est sirupeux, et pas même de fabrication locale. Nous ne consommons ni cigares ni whiskies, et regagnons bien vite nos chambres respectives dans l’auberge au plancher craquant.
15/10
Depuis la gare d’Aomori, il n’y a d’autre moyen de se rendre aux quais de ferries qu’à pied, ou en taxi. La matinée est belle. Je traîne donc l’incorruptible valise sur près de trois kilomètres à travers de magnifiques non-lieux vaguement portuaires aux trottoirs défoncés, éloquents dans leur hostilité au piéton, et pour cette raison même empreints d’un charme bien à eux.
Les employés de la compagnie de ferries Seikan n’ont pas l’air plus surpris que cela de me voir surgir sans véhicule. Pourtant je serai le seul passager-piéton sur le navire, principalement emprunté par des chauffeurs de poids-lourd en raison de l’absence de tunnel routier. Trajet peu remarquable, si ce n’est une regrettable absence de toute nourriture à bord, nouilles instantanées exceptées. Il fait bon somnoler sur les grands tatamis vides.
Arrivée flamboyante à Hokkaido près de quatre heures plus tard, dans l’explosion solaire de fin de journée au-dessus de la zone industrielle, miroir de celle dont nous sommes partis. On m’indique aimablement quel bus prendre pour rejoindre le centre-ville d’Hakodate, et je patiente dans le concert insistant d’une volée de mésanges, passereau emblématique de la ville.
Je n’ai que le temps de faire un petit tour du quartier historique de Motomachi avant de prendre le train pour ma prochaine destination. Vieux tramway en pâte d’amande qui évoque Dalian ou Hong Kong ; façades opulentes de vénérables pâtisseries ; église orthodoxe russe à dômes en oignons verts ; hôtel de ville baroque néo-classique victorien rococo couleur crème et citron, sorte de cauchemar d’architecte lusitano-russe saisi d’indigestion qu’un riche marchand de l’ère Meiji aurait mieux fait de ne pas se ruiner à financer ; toutes choses fort sympathiques et qui fleurent bon le dix-neuvième siècle.
Au-dehors de la minuscule gare de Shikabe : forêt, étoiles. La nuit est noire, dense et profonde. Bientôt percée par les phares de la voiture de Dori. Elle a proposé de m’héberger en raison du réseau de coïncidences qui nous réunissent : entre autres, elle a 29 ans, et se nomme Dori Ann. Originaire du Kansas, elle vit au Japon depuis bientôt sept ans, et parle un japonais très correct. Professeur d’anglais en école primaire et au collège, elle est aussi sumotori à ses heures et lauréate de la médaille d’argent du championnat féminin de sumo de l’année dernière.
En compagnie de ses collègues et amies, dîner au restaurant Big Sushi, réputé dans toute la région. Et je comprends vite pourquoi. Au menu, à part d’excellents maki et autres sushi d’une fraîcheur irréprochable, une assiette de gimpari (?), poisson caramélisé, délice suprême. Dori s’entend avec le maître de maison comme larrons en foire, tant et si bien qu’il nous offre en fin de dîner des échantillons supplémentaires de son art.
Évoquant son expérience de vie sur place, Dori me parle de ce contraste étrange entre le confort et l’accueil chaleureux qui ravissent l’étranger en visite, et la xénophobie indécrottable des Japonais dont tout résident finira par s’apercevoir sur le long terme. Un signe parmi tant d’autres, le tollé que provoqua l’élection au titre de Miss Japan d’une Afro-Japonaise ayant passé toute sa vie sur place – dénigrée comme étant une simple hafu (« half ») et donc indigne du titre par toute une partie de la population. Vénération du pedigree.
C’est un pays où toute différence est immédiatement ciblée et rejetée par le corps social comme une dangereuse tare. Ainsi ces employés dont les performances au travail leur offrent le droit de prendre plus de vacances que leurs collègues, mais qui délaissent ce bonus pour ne pas s’attirer de ressentiment – pire, parce qu’ils en concevraient une véritable honte. Ou encore, ces enfants de couples mixtes, qui « oublieront » le plus vite possible l’anglais appris dans leur plus jeune âge une fois entrés au collège. Comment peut fonctionner une société qui procède de façon systématique à un tel nivellement par le bas ?
Dori me parle aussi de l’état déplorable du système éducatif. Il n’est possible ni d’expulser un élève d’un établissement, ni même de le faire redoubler. Peu étonnant dès lors que la majorité des gens n’aient qu’une maîtrise infime de l’anglais, qu’ils n’auront jamais eu l’obligation d’étudier de façon approfondie contrairement aux étudiants coréens ou même chinois. Mais aussi courante qu’elle soit, cette carence est aussi source de honte : il n’y a que les enfants et les personnes âgées qui parlent volontiers aux étrangers, se moquant bien de « perdre la face » du fait d’une communication inadéquate – un nouveau terme est même apparu pour désigner une certaine classe de vieilles dames qui ont tout vu et n’ont peur de rien : les obaa-talion (contraction de obaa-san, « grand-mère, » et de l’anglais batalion)… Les amis japonais de Dori sont donc sensiblement plus vieux qu’elle.
Malgré tout, elle aime trop ce pays pour le quitter. (Il est des pays qui façonnent une personne, de sorte que les deux en deviennent à peu près indissociables – ou des personnes qui trouvent un sens à leur existence dans ce façonnement…)
16/10
Sur le conseil de Dori, passage par le parc naturel « quasi-national » de Onuma. Archipel d’îlots boisés, émergeant à la surface de plusieurs lacs créés par une éruption volcanique il y a quelques siècles.
Nature splendide, encadrant le pic un peu crochu du mont Komagatake. Les eaux sont le territoire des canards, et les arbres aux feuilles de feu sont autant de perchoirs à corbeaux. Par bonheur, les hordes de touristes taïwanais à drapeaux se cantonnent sagement aux bateaux à moteur qui sillonnent l’espace de loin en loin, effrayant les canards. Dégustation d’une ikasumi ice, glace à l’encre de poulpe. C’est noir, mais ça a surtout goût de vanille.
Le dernier train de ce voyage, un limited express dans lequel une place finit par se libérer, me porte à toute vitesse jusqu’à Sapporo, en trois heures somnolentes et crépusculaires.
Première impression : celle d’une ville au cœur palpitant, loin de la bourgade provinciale à laquelle on pourrait s’attendre. Couloirs de métro bruissant d’humains pressés, et sûrs d’eux. Pourtant les déplacements sont faciles, les transports bien pensés, on est loin du point de saturation. En un rien de temps je suis à Susukino, le quartier fêtard (« le plus grand du Japon après celui de Tokyo »), où les rues sont pleines de jeunes gens aux cheveux multicolores et costumes évoquant tantôt Blade Runner, tantôt Harry Potter. Énormes enseignes au néon vantant les charmes qui d’un téléphone rose, qui d’un restaurant à ramen au beurre ; dominant le paysage sur la rive nord, une grande roue scintillant de tous ses feux. Ici ou là, une personne au genre indéterminé braille du John Lennon éraillé sur une guitare déglinguée, pour la plus grande joie de quelque salaryman éméché, cravate de travers, qui se trémousse bière à la main.
Le deuxième capsule hotel dans lequel je descends pour clore ce voyage, en écho à celui par lequel je l’ai débuté, est un petit bijou. Les capsules sont deux fois plus grandes que celles du Cube d’Hiroshima, et fin du fin, le prix très modique inclut l’usage d’un onsen au huitième étage. Immergé dans le bain miraculeux, je me laisse absorber, l’œil vitreux, dans un programme télévisé qui met en scène deux Japonais visitant la Chine. L’un des petits plaisirs de mes voyages au Japon a toujours été l’appréciation de ce sourire poli (« Tiens donc ? »), suivi d’une bifurcation immédiate dans la conversation, qu’on me réserve quand je mentionne avoir passé six ans à Pékin ; je pourrais aussi bien leur dire que mon passe-temps favori est la pratique du trapèze en slip léopard.
Propre et cramoisi, impossible de me cloîtrer derechef dans cette capsule, si confortable soit-elle. Comme je cherche en vain un certain bar, hébété, parmi les milliers d’établissements concentrés dans ces quelques pâtés de maisons, je tombe sur une enseigne intéressante : Bar Crève ! – Neuvième étage. Impossible de ne pas aller jeter un coup d’œil.
C’est l’un de ces bars qui peuvent contenir à peine dix personnes tout au plus. Quatre salarymen sont accoudés au comptoir, résolument engagés sur la voie de l’ébriété. Un silence gêné tombe quand je fais irruption — pour se dissiper, en un grand soupir de soulagement collectif, sitôt que ma capacité à communiquer en japonais, si médiocre soit-elle, est avérée (cette créature est presque humaine !).
Le patron, M. Takefumi Tokiwai, quant à lui, ne parle pas un traître mot de français. Il cherchait simplement un nom accrocheur pour son nouveau bar à shots, et comme beaucoup de ses compatriotes blasés de l’anglais, il s’est tout naturellement tourné vers la langue de Molière. L’injonction sur laquelle il a jeté son dévolu lui a paru, selon la définition proposée par son dictionnaire, symboliser d’une bien belle manière l’esprit hardi, masculin, intrépide, auquel il associe tout naturellement la consommation cul-sec de petits verres d’alcool.
Les salarymen travaillent tous pour une même compagnie qui fabrique des pylônes en béton. Ma conversation avec eux a beau rouler — bien obligé — sur des sujets relativement basiques (« Aimes-tu le baseball ? » « Moi, j’aime la bière ! »), on s’entend de mieux en mieux ; et bientôt l’homme à lunettes un peu plus âgé, qui garde ses distances au bout de la table et dont on comprend vite qu’il s’agit d’un supérieur hiérarchique, me paie une autre Kirin, puis un verre de shoju. Quand j’annonce finalement mon départ, M. Takefumi insiste pour m’offrir, très cordialement, plusieurs sachets de biscuits apéritifs, « pour la route, » et me raccompagne jusqu’à l’ascenseur avec force saluts et une chaleureuse poignée de main.
Sapporo.
















































































































































































































