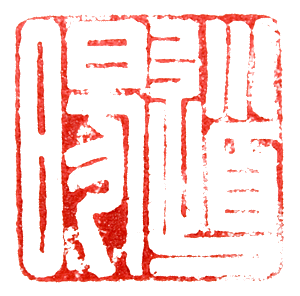Un mois dans la communauté Yamagishi (Partie 2)
« Bien, et maintenant que diriez-vous de déposer votre portefeuille dans cette enveloppe ? Vous n’en aurez besoin à aucun moment jusqu’à votre départ, et il sera plus en sécurité ici que dans votre chambre : comme vous avez pu le constater, votre porte n’a pas de verrou. »
Je sais pour avoir lu à son sujet que la communauté Yamagishi revendique un mode de vie aussi détaché que possible du « monde de l’argent » ; pourtant, cette proposition me prend de court. Elle survient au terme d’une visite au pas de course des différents bâtiments qui vont s’avérer les plus essentiels à ma survie pendant les trois semaines à venir : ma chambre ; le réfectoire ; la salle de bains ; et enfin le bureau madoguchi (« fenêtre »), interface entre la communauté et le monde extérieur – le sas, ou lieu de quarantaine en quelque sorte, où se règlent les questions financières. C’est un tout petit bâtiment qui évoque un antique bureau des PTT au fin fond de la Sibérie : torpeur, odeur de poussière et de formica, coloris jaunes-beiges-orangés.
Sans doute suis-je encore trop prisonnier de la pensée matérialiste, mais toujours est-il que je n’aime pas beaucoup qu’on me demande mon portefeuille à brûle-pourpoint, avec ou sans l’appui d’une arme. Je suis traversé d’un éclair de suspicion : Est-ce un test ? Ou peut-être un stratagème visant à m’empêcher de quitter les lieux ?
J’hésite – mais bientôt, avec la même espèce de longue inspiration un peu contrariée que prend le nageur soudain saisi d’un doute quant à sa propre santé d’esprit, alors qu’il est sur le point de se jeter dans l’eau glacée d’un lac hivernal, je décide tout de même de jouer le jeu. J’écris mon nom sur l’enveloppe de papier brun passablement défraîchie, et la scelle d’un bout de ruban adhésif. Elle disparaît derrière le comptoir, et avec elle mes cartes bancaires ainsi que tout l’argent liquide en ma possession. On ne me donne aucun reçu, évidemment.
« Bienvenue à Kasugayama ! »
Ma semaine de Tokkoh vient juste de se terminer (voir la partie précédente). Comme prévu, en l’échange de la gratuité de mes frais d’inscription au séminaire, je m’apprête à travailler pendant vingt jours dans ce « village Yamagishi », ou jikkenchi. Ce dernier terme signifie à peu de chose près « lieu de mise en pratique de la société idéale. » Le site officiel de l’Association Yamagishi en dénombre vingt-six dans tout l’archipel japonais – des confins septentrionaux de Hokkaido à l’île semi-tropicale de Kyushu.1 Plus de 1250 personnes y mettent en pratique, jour après jour, la philosophie de l’Association.
Le village de Kasugayama est situé en plein cœur de la préfecture de Mie, une région verdoyante, fertile et à dominante agricole, à mi-chemin entre les immenses conurbations d’Osaka et de Nagoya. Ce fut le premier jikkenchi à être établi par le fondateur du mouvement, Yamagishi Miyozo (1901-1961), et une vingtaine de ses amis, en 1958, ce qui en fait la deuxième plus ancienne « communauté intentionnelle » existant au Japon.2 Près de 200 personnes y sont établies à présent.
Quelle sont donc les caractéristiques de cette « société idéale » dont les jikkenchi cherchent à faire la démonstration ?
LA RECHERCHE D’UN EQUILIBRE
Dès le lendemain de mon arrivée, comme je rejoins le département « Légumes, » on m’en offre un très clair aperçu : à l’image d’un kibbutz israélien, cette société idéale sait avant tout survenir dans une large mesure à ses propres besoins. La vie dans les jikkenchi repose en effet principalement sur le travail de la terre sous toutes ses formes, qu’il s’agisse de la culture de fruits, de légumes, de blé ou de riz, voire de thé, ou encore de l’élevage bovin, porcin, ou de poulets fermiers. Si l’on inclut la fabrication de produits alimentaires plus sophistiqués – pain, nouilles, condiments et sauces ou laitages – ce sont plus d’une cinquantaine de produits qui sont issus du réseau des villages Yamagishi, aboutissant à une situation de quasi-autosuffisance alimentaire : selon M. Kitaoji, travaillant au département de l’Approvisionnement de Kasugayama, près de 95% des aliments consommés dans les jikkenchi sont des produits Yamagishi.3 Ce réseau est étroitement intégré par un réseau de transports perfectionné, permettant aux jikkenchi d’échanger leurs produits entre eux : ainsi, tel village fournira principalement du riz, tel autre des fruits, un autre encore des œufs et de la viande, etc. De par sa taille et ses ressources, celui de Kasugayama est doté d’une production très diversifiée.
Ces produits sont aussi vendus à l’extérieur de la communauté. La distribution s’effectue dans des supermarchés, en ligne par le web-store de l’Association, et même en vente directe dans quelques magasins gérés par les membres. La marque Yamagishi bénéficie d’une excellente réputation : pour avoir passé deux jours dans l’une de ces boutiques, je peux témoigner de leur très grand succès auprès des riverains – le magasin ne désemplit pas du matin au soir. Peu étonnant, au vu de la très haute qualité de ces produits, qui incluent par exemple de la viande de boeuf wagyū, réputée dans le monde entier. Des milliers de consommateurs achètent des produits Yamagishi chaque jour.
Pourtant, aucun de ces produits ne porte le label « agriculture biologique. » S’agit-il donc d’agriculture conventionnelle ? Loin de là. L’état d’esprit de l’Association accorde bel et bien une grande importance au respect de l’environnement : l’usage de pesticides et autres intrants chimiques est minimisé, et un système de recyclage des déchets particulièrement sophistiqué est mis en œuvre pour la production d’aliments animaliers ou de fumier – une vaste section de Kasugayama est même principalement dédiée au traitement et à la production de compost pour le bénéfice des autres villages. Comme le note Ernest Callenbach lors de sa visite, « [leurs] plantes sont si saines qu’elles n’ont pratiquement pas besoin de pesticides. »4 Cela expliquerait le succès considérable que connaît, auprès des fermiers locaux, la vente de semis Yamagishi dans leur pépinière de Toyosato : « Lors de nos deux saisons de vente, au printemps et à l’automne, notre pépinière est dévalisée » constate, ébahie mais pas peu fière, Mme. Rita Kajiyama, une Suissesse venue s’installer avec son époux à Toyosato dans les années 1980. « Mais après tout, nous ne cherchons pas à en tirer profit financier, nos prix sont donc extrêmement modiques… »
Par conséquent, bien que la production agricole selon la communauté Yamagishi s’efforce d’être soutenable, les jikkenchi ne sont pas pour autant des « écovillages » à l’Occidentale. Selon M. Kitaoji, « il s’agit pour nous de trouver un équilibre entre notre propre satisfaction et le respect de l’environnement. Nous ne voulons pas faire “du soutenable” juste “pour être soutenables”. » En d’autres termes, la question du label bio est subsidiaire : ce qui compte est avant tout pour les membres de l’Association de faire les choses d’une façon qui leur semble rationnelle et en accord avec leurs valeurs. L’application de principes scientifiques dans la recherche du bonheur est leur objectif capital, et vivre en harmonie avec la nature participe simplement de la poursuite de cet objectif.
L’agriculture constitue aussi un facteur de lien social important. Ainsi, selon la saison, les jeunes gens qui vivent dans les différents jikkenchi se rassemblent dans l’un ou l’autre village quand un fort besoin de main-d’œuvre se fait ressentir : en mai, ils vont ainsi planter du riz pendant une semaine dans le jikkenchi d’Akita (nord du Japon) ; en décembre, ils se retrouvent pour la cueillette des mandarines à Mutsugawa (au sud de Kyoto). Et après une dure journée de travail, place à la fête.
C’est une agriculture moderne qui est employée, faisant usage de technologies souvent sophistiquées (ainsi des trayeuses de vaches robotisées, dernier cri), mais qui s’appuie aussi sur une main-d’œuvre attentive et qualifiée lorsque c’est nécessaire. En tant que membre de l’équipe maraîchaire de Kasugayama, je suis ainsi frappé du temps considérable passé jour après jour dans le but de treillisser et dorloter des centaines de plants de tomates… Mais la quantité comme la qualité les récoltes en valent la chandelle – ces tomates sont énormes, juteuses, d’une saveur inoubliable. Chaque repas dans le grand réfectoire est une véritable expérience gastronomique.
ÊTRE PLUTÔT QU’AVOIR
Bien entendu, l’un des facteurs permettant aux jikkenchi de produire des aliments d’une si haute qualité, et de les vendre à prix compétitifs, est aussi le fait que la plupart du travail est effectué… de façon non salariée. En effet, bien que certains des villages embauchent des employés saisonniers ou à temps plein,5 les membres de l’Association – qui représentent la majorité des travailleurs – n’attendent de recevoir aucune rémunération directe.
La philosophie qui sous-tend la vie dans les villages Yamagishi met en effet l’accent sur le détachement vis-à-vis des biens matériels, et sur l’usage égalitaire des ressources communes. Pas de demi-mesures : tout nouveau membre de l’Association est censé verser en contribution la totalité de ses avoirs financiers et matériels6 – en l’échange de quoi il ou elle gagne une garantie d’accès à l’intégralité des biens de l’Association : logement et alimentation, bien sûr, mais aussi sécurité sociale intégrale (une maison de retraite confortable est même intégrée au jikkenchi de Kasugayama), utilisation de différentes infrastructures (piscine et terrain de sport, laverie, réseau téléphonique et Internet), accès à un parc de véhicules… S’ils le souhaitent, les membres peuvent cependant retirer de l’argent auprès du madoguchi évoqué plus haut, afin d’effectuer hors de la communauté des achats à fins de consommation personnelle (livres, CD, vêtements, alcool, etc.). À noter que pour des achats privés plus conséquents, certains pourront décider de travailler hors de la communauté pendant un temps afin de gagner l’argent nécessaire.7
Bref, pas question de sacrifier le confort sur l’autel de l’anti-matérialisme. L’intégralité des bénéfices dégagés par la vente des produits agricoles du réseau Yamagishi sont investis dans la construction, l’entretien, l’amélioration et le fonctionnement des différents jikkenchi (incluant le cas échéant l’emploi de main-d’œuvre extérieure), au profit de la collectivité des membres – qui peuvent cependant puiser dans ce flux de revenus pour leur satisfaction individuelle. Mais si l’on n’a que des besoins modestes, qu’on mange au réfectoire et qu’on s’habille au dépôt de chaussures et de vêtements du village, il est envisageable de vivre confortablement sans jamais avoir à manipuler un seul billet de banque.
La communauté Yamagishi vise donc à bâtir un mode de vie plus simple, plus convivial, libéré des classes sociales comme de la consommation ostentatoire – sans pour autant se montrer luddite, contrairement aux Amish par exemple. D’après mon expérience, l’atmosphère d’un jikkenchi est considérablement plus informelle et chaleureuse que dans la société japonaise de manière générale ; et le fait qu’il n’y ait dans ces lieux aucune hiérarchie y contribue de façon évidente. En effet, l’Association Yamagishi se veut égalitaire non seulement du point de vue matériel, mais aussi politique.
EVITER LA TENTATION DU CHEF
La communauté Yamagishi est née de la volonté de son fondateur éponyme, Yamagishi Miyozo – qui s’opposa, sans succès, à l’emploi de son patronyme pour la désigner.
Dès l’origine, son ambition est de jeter les bases d’une société spirituellement supérieure – mais non religieuse – mettant à la portée de chacun la possibilité du « bonheur véritable. » C’est une visée fondamentalement égalitaire : selon lui, « une société qui provoque le malheur de certains [pour assurer le bonheur d’autres personnes] n’est pas une société réellement heureuse. » Pourtant, cela présuppose non l’uniformité des activités et des modes de vie, mais au contraire un accès égal à la liberté propre – celle de « manger quand on le souhaite, sans y être forcé quand on n’a pas faim » ; celle de « vivre dans n’importe quel genre de maison, (…) se reposer autant que nécessaire, se réveiller quand on le souhaite. »8 C’est aussi la liberté de travailler et d’employer ses compétences propres aux tâches qui conviennent le mieux à chaque individu.
Cette logique de l’égalité est poussée jusqu’à sa conclusion logique : si nous sommes tous égaux, alors personne n’est en droit de donner des ordres à qui que ce soit. De fait, le réseau Yamagishi n’a pas de chef. Comment ces villages fonctionnent-ils donc, au jour le jour ?
La prise de décision s’effectue au sein de groupements créés sur la base des activités des membres. Un jikkenchi de moins de vingt résidents ne représentera en général qu’un seul groupement, mais un village plus large comme celui de Kasugayama sera constitué de multiples shokuba (« groupes de travail » ou « départements ») : département des Légumes, des Porcs, des Poulets, mais aussi Restauration, ou encore Madoguchi. Chacun de ces départements fonctionne de façon autonome, mais en coordinant ses activités avec celles des autres. Au sein de chacun d’eux, un kakari (« responsable ») est choisi par ses pairs pour représenter son département lors de réunions requiérant sa présence ; ce responsable est en principe choisi sur la base de ses compétences, et sa position est à mi-chemin de celle d’un député et d’un simple agent de liaison. En tout cas, il n’est pas censé être le chef de son département, même si son avis est d’un poids certain dans les discussions. Tous les six mois, son mandat est remis en jeu, et peut être soit transféré à une autre personne, soit renouvellé.
Les responsables d’un même jikkenchi choisissent aussi tous les six mois une ou plusieurs personnes pour représenter leur village lors des différentes réunions de l’Association qui se déroulent à l’échelle nationale. Chacune de ces réunions forme un comité ou groupe de réflexion concernant des thèmes aussi divers que la production agricole, la restauration, les transports… Les fruits de leurs discussions feront ensuite l’objet de nouvelles délibérations au sein de chaque village. Mais quel que soit le rôle qu’il ait à jouer de temps à autre dans ces réunions, le kakari est avant tout un membre ordinaire de l’Association, travaillant jour après jour avec ses collègues au sein d’un département – et non pas un représentant à temps plein. La communauté Yamagishi tient en effet à éviter la formation d’une classe de cadres décidant du devenir collectif, contrairement aux modèles communistes. Par ailleurs, mes interlocuteurs mettent aussi souvent l’accent sur la nécessité d’inclure de « non-experts » au sein de tout comité, afin d’éviter de tomber dans une forme de technocratie ignorante du bon sens des gens ordinaires.
Certes, la mise en place de ce mode de fonctionnement décentralisé a été (et reste) un défi, comme on pourrait s’y attendre – tout particulièrement au sein d’une société japonaise fortement marquée par le confucianisme, attachée aux hiérarchies et à la présence d’un « leader ». Le fondateur du mouvement lui-même, de l’avis général, en était tout à fait conscient. Yamagishi Miyozo se considérait sûrement comme un initiateur, mais il mit toujours un point d’honneur à ne pas jouer un rôle de « leader » ou de « guru » : ainsi, bien qu’il participât avec ses amis à l’établissement du premier jikkenchi de Kasugayama, en 1958, il préféra paradoxalement vivre en-dehors, redoutant sans doute les périls du culte de la personnalité qui eût pu s’ensuivre contre son gré. Aujourd’hui, on ne voit aucune photo de lui où que ce soit dans le village. L’égalité et la communauté de destin des membres de l’Association trouve son symbole le plus mémorable dans le mausolée situé au cœur de Kasugayama, où sont entreposées les cendres de tous les membres décédés, au côté des restes de Yamagishi Miyozo lui-même.
Les habitants des jikkenchi hésitent à aborder la question, mais de temps à autre on évoque en ma présence tel ou tel individu qui aurait, quant à lui, fini par succomber à cette « tentation du chef » et s’exagérer sa propre importance au sein de la communauté ; de telles affaires semblent s’être souvent soldées par un départ de la personne en question, partant fonder sa faction dissidente ailleurs, accompagnée de ses suiveurs. Toutefois, nulle de ces factions ne semble avoir perduré bien longtemps.
Il est sans doute inévitable qu’au sein de tout groupe, telle ou telle personne en vienne à acquérir une autorité particulière, du fait de sa personnalité ou de ses capacités. Au cours de ma visite, j’ai fait la rencontre de plusieurs personnes dont le charisme et l’influence étaient tout à fait palpables : ainsi M. Kitaoji, un homme d’une soixantaine d’années au sourire facile et d’allure affable, qui prit part dans sa jeunesse à des mouvements révolutionnaires estudiantins ; il répugne à s’apesantir sur son rôle, mais il est de toute évidence une personnalité de premier plan en tant que l’un des représentants du jikkenchi de Kasugayama. Même en des situations où il ne « décide » rien, son avis ou ses « conseils » sont pris très au sérieux.
Comment une société se voulant non-hiérarchique peut-elle alors, à tout le moins, décourager l’accumulation du pouvoir entre les mains de personnalités charismatiques ? Au-delà de l’absence de structures décisionnelles verticales, l’un des éléments de réponse essentiels proposés par la communauté Yamagishi est la pratique du kensan.
COMMUNIQUER RÉELLEMENT
Le terme kensan, qui signifie à l’origine « étude approfondie », désigne les assemblées informelles au cours desquelles tout se discute au sein de la communauté – depuis l’allocation des tâches et des ressources jusqu’à la résolution des conflits, en passant par la coordination économique des activités des divers jikkenchi. Quand il s’agit de prendre une décision, ces réunions visent à faire émerger la solution jugée la meilleure possible par l’ensemble des participants, sur la base d’une discussion raisonnable et approfondie.
Mais au-delà de l’aspect pratique, le kensan est avant tout une attitude, une forme de courtoisie sincère dont j’ai fait l’expérience avec mes camarades lors de notre séminaire de Tokkoh. En résumé, il s’agit d’aborder toute question dans un esprit d’objectivité et d’honnêteté, en s’efforçant de ne jamais se mettre en colère ni d’exercer quelque forme de violence que ce soit. On a le droit d’être en désaccord avec autrui, mais il faut alors communiquer cette divergence d’une manière raisonnable et non-agressive. Il s’agit de s’approcher, de manière individuelle et collective, d’une vision des choses « telles qu’elles sont réellement » – et d’aboutir ainsi à une entente mutuelle.
Cette recherche de la solution la meilleure s’accompagne néanmoins d’une conscience aiguë de la faillibilité humaine, qui prive chacun de l’accès à la moindre connaissance éternelle. C’est de fait l’un des principaux credos de l’Association : toute proposition peut et doit être considérée et reconsidérée d’un point de vue critique. Cet attachement primordial à la raison et au dialogue va de pair avec la non-religiosité tolérante de l’organisation, dont les membres font de toute croyance une affaire strictement personnelle. Nul texte, pas même les écrits du fondateur du mouvement, n’est considéré comme sacré ou indiscutable ; et la vie en jikkenchi ne s’appuie sur aucune constitution, texte de loi ou code de conduite en particulier, si ce n’est que l’Association et ses membres s’attachent à respecter la loi japonaise, « pour éviter les ennuis ».
Chaque membre d’un groupe de travail participe en général à une ou deux réunions kensan par jour, avec ses collègues ; pendant ces séances très détendues, autour d’une tasse de thé et d’une assiette de gâteaux, chacun est encouragé à s’exprimer sur son travail, sur la meilleure façon de répartir les tâches, ou à faire part aux autres de ses requêtes – une demande de congés, par exemple, sera acceptée de bonne grâce. En effet, si les membres d’un jikkenchi sont tout aussi industrieux que leurs compatriotes à l’extérieur de l’organisation, ils sont bien plus à même de réguler leurs activités et leur rythme de travail en harmonie avec les besoins de la communauté : sans horaires fixes ni supérieurs hiérarchiques, chacun est libre de fixer son propre emploi du temps tant que cela ne provoque pas de tensions avec son entourage. Difficile d’imaginer des situations de karoushi – mort subite dûe à l’épuisement – comme celles qui frappent le proverbial salaryman nippon !
Cependant, tout un chacun peut aussi spontanément inviter quelques amis ou connaissances à former une réunion kensan, le temps d’un soir ou régulièrement, et ce à propos de n’importe quel sujet : pendant mon séjour, quelques amis me convient ainsi à une réunion visant à débattre de si, oui ou non, « le bonheur véritable est un état d’esprit inchangeant »… Les conclusions éventuellement tirées de ces rencontres, en particulier lorsqu’elles concernent les aspects concrets de la vie en jikkenchi, pourront alors percoler vers d’autres personnes et groupes et influer sur le cours des choses. La multitude de petits comités, plus ou moins formels et fluctuants, qui se forment ainsi dans l’ensemble de la communauté, semblent diffuser et contrebalancer de manière efficace toute forme de pouvoir ou d’influence individuelle, et offrir à chacun la possibilité de faire entendre sa voix de manière démocratique : tout membre possède un droit de véto au sujet des décisions prises au sein de son village.
La cohésion de la communauté à l’échelle du pays est aussi assurée par le biais de moyens de communication efficaces, permettant une solide intégration, et facilitant l’émergence d’un sentiment d’appartenance grâce à la circulation des personnes, des biens et de l’information. Outre le partage quotidien de différentes denrées alimentaires entre les différents villages, les membres eux-mêmes déménagent fréquemment de jikkenchi en jikkenchi, que ce soit dans l’intention de s’essayer à de nouvelles tâches, ou simplement pour goûter à la vie dans différentes régions de ce pays aux climats et paysages si variés qu’est le Japon. Par ailleurs, les membres échangent – de façon quotidienne et très active – informations, articles, conseils pratiques et photos sur le site-forum de l’Association,9 et publient aussi un journal mensuel distribué dans tout le pays : le bien-nommé Kensan.
Mais qui sont ces membres, au juste ?
PROFILS EN TOUS GENRES
La communauté Yamagishi, depuis sa création dans les années 1950, ne cesse d’évoluer en phase avec la société japonaise, dont elle ne cherche aucunement à se couper – et cette approche est sans doute largement à créditer pour la pérennité remarquable de cette organisation, contrairement à d’autres « communautés intentionnelles » cherchant à survivre en isolation.10
Au cours de la première décennie suivant la fondation de l’Association, la plupart de ses membres viennent d’un milieu rural et agricole ; c’est en effet en tant que fermier, et inventeur de techniques agricoles particulièrement soutenables et productives, que Yamagishi Miyozo se fait connaître dans un premier temps (voir l’encadré). La communauté connaît une croissance importante pendant les années 1970, sous l’influx de centaines de jeunes militants issus des causes communistes ou pacifistes et déçus par le conservatisme de la société japonaise – ainsi M. Kitaoji, mentionné plus haut, figure de proue de ces mouvements au sein du fameux lycée Aoyama de Tokyo ; mais peu d’entre eux restent bien longtemps, regrettant peut-être le pragmatisme discret, peu enclin au radicalisme, caractérisant la vie en jikkenchi. Une autre vague importante de nouveaux arrivants survient dans les années 1990s, à l’époque où s’effondre le « miracle japonais, » laissant place à une désillusion vis-à-vis de la société toute entière.
« Soudainement, tout sembla possible, » me confie Rita Kajiyama. « Notre mouvement fut rejoint par des gens hautement qualifiés venus de tous les milieux : scientifiques, chirurgiens, pilotes d’avion, hauts fonctionnaires… Nous nous sommes sentis très forts, très confiants. » Trop confiants ? C’est à cette époque d’expansion soudaine que se multiplient les ennuis pour la communauté. En effet, près d’une trentaine de membres décident de quitter l’Association pendant cette décennie, et lui intentent des procès afin de récupérer les biens qu’ils y avaient pourtant légués « sans conditions », selon les déclarations signées par chacun d’eux à leur arrivée.11
Aujourd’hui, l’Association Yamagishi s’est faite plus discrète, et semble connue principalement dans les régions où sont implantés les jikkenchi. « Nous ne sommes pas très doués pour la publicité, » avoue Rita. « Nous nous efforçons simplement de faire notre travail du mieux possible, chacun dans son coin. » C’est peut-être là que le bât blesse : le fonctionnement radicalement décentralisé de l’Association, entité protéiforme qui ne se fixe ni plans quinquennaux ni autres stratégies à long-terme, lui confère une certaine passivité vis-à-vis des évolutions de la société qui l’entoure. Par exemple, en cette époque désenchantée, peu de jeunes japonais semblent tentés par la vie en communauté intentionnelle ; la plupart des gens que je croise dans les jikkenchi ont plus de quarante ans, souvent largement plus. Cette situation reflète certes la réalité d’une société japonaise vieillissante, mais on pourrait imaginer qu’une orientation stratégique d’envergure pourrait aider l’Association à mieux surmonter les aléas de l’histoire et les tendances sociales du moment, en faisant par exemple valoir auprès des jeunes les avantages du mode de vie innovant qu’elle a inventé depuis sa création. À défaut, l’élévation de l’âge moyen des membres nécessitera le recrutement de travailleurs agricoles salariés de plus en plus nombreux, ce qui pourrait entraîner à terme une transformation de l’Association en coopérative agricole ordinaire.12
Cependant, objectera-t-on, la vie dans les villages Yamagishi est-elle vraiment de nature à intéresser les jeunes ?
LA NOUVELLE GÉNÉRATION
De toute évidence, les habitants de ces villages privilégient une existence plus sereine, paisible, et dénuée de compétition, aux antipodes de celle des citadins ordinaires : on connaîtra peu de poussées d’adrénaline en jikkenchi ! Par ailleurs, emménager dans l’un de ces villages signifie rejoindre un contexte intensément collectif, qui s’il est source de chaleur et de solidarité, prive tout un chacun d’une certaine forme de liberté individuelle et d’anonymat dont peuvent jouir les habitants des mégalopoles.
Pourtant, si la vie dans les villages Yamagishi est affaire de compromis et de négociations quotidiennes, toute initiative personnelle n’est pas bannie, loin de là. Ainsi, M. Masuya, qui travaillait autrefois à la laiterie dans le jikkenchi de Toyosato, déclare un beau jour qu’il aimerait cesser de traire les vaches, et s’occuper d’un jardin. Après discussion de sa proposition, un lopin de terre en friche est placé sous sa garde ; désormais, fier comme un roi, il passe ses journées à arpenter son magnifique jardin, où poussent aussi bien fleurs qu’arbres fruitiers. Il vend certes ses semis aux fermiers des alentours, mais le sens principal de son activité est moins question d’économie que de plaisir – le sien propre, et celui du reste de la communauté, où il exerce ses talents de paysagiste. On me parle aussi d’un autre membre, féru de voyages autour du monde, dont les déplacement s’effectuent aux frais… de l’Association. « Pourquoi pas, si ça lui plaît ? »
Rita, quant à elle, décide un beau jour de se lancer dans la boulangerie. « Le pain suisse me manquait. » Elle milite donc pour l’achat de fours à pain, trouve les recettes sur Internet, organise l’achat des ingrédients – et entame sa première fournée. Trois années plus tard, elle a fait des dizaines d’adeptes parmi les japonais de la collectivité, qui étaient pourtant loin d’être de grands mangeurs de pain – culture nippone oblige ! Désormais, une fois par mois, une douzaine de personnes venues de différents villages s’inscrivent pour participer, le temps d’une matinée industrieuse, à la fabrication (et à la dégustation) de 13 différentes sortes de pain. L’occasion d’apprendre de nouvelles compétences, et de se divertir. Ces 260 kg, élaborés en un temps record, seront savourés en lieu et place du riz ordinaire par des centaines de personnes aux tables de cinq jikkenchi, le temps d’un repas.
D’autre part, si la vie dans ces villages est principalement centrée sur l’agriculture et diverses activités connexes, chacun est bien sûr invité à tirer parti de toutes ses compétences professionnelles, ce qui ouvre de nombreuses possibilités dans un contexte économique japonais assez morose. Le village de Toyosato inclut notamment une clinique, et propose des cursus éducatifs agricoles permettant aux pédagogues d’exercer leurs talents. Certains membres apportent aussi avec eux un savoir-faire spécifique très utile à l’Association dans ses contacts avec le reste de la société, à l’instar de M. Orihara, dont l’activité principale est la gestion des questions d’assurances de la communauté dans l’ensemble du pays… Sans même parler des travaux de comptabilité, d’administration, d’informatique, ou encore de bâtiment, nécessaires au bon fonctionnement quotidien de la collectivité.
Sur le plan culturel, néanmoins, et en particulier sur celui des relations hommes-femmes, la communauté Yamagishi reflète assez fidèlement la structure traditionnelle japonaise, qu’une sensibilité occidentale ou progressiste jugera sans doute quelque peu patriarcale, ou conservatrice. Ainsi, la plupart des tâches sont clairement distribuées entre les sexes – que ce soit sur la base de la force physique, ou non. Par exemple, on voit très rarement un homme faire la cuisine ; et dans le jikkenchi de Misato, la cueillette du thé est strictement réservée aux hommes. De même, hommes et femmes portent des habits de travail différents. Quant à la cellule de base de la communauté, elle reste le couple marié, partageant un appartement au sein d’un bâtiment résidentiel. Il semble difficile d’imaginer, par exemple, un couple demandant à construire sur le jikkenchi une maisonnette individuelle pour y vivre indépendamment des autres villageois.
Reste à souligner tout de même une volonté assez remarquable de transformer les mentalités des gens au sein de la communauté, dès leur plus jeune âge : ainsi, les parents sont encouragés à envoyer leurs jeunes enfants grandir dans les dortoirs établis au sein des jikkenchi, afin que ces derniers puissent grandir « sans hériter des idées de leurs parents » – avec qui ils ne passent que deux ou trois jours par mois. Cependant, ce choix reste optionnel : certains enfants quittent leurs parents dès l’âge de six ou sept ans, d’autres bien plus tard – voire pas avant leur adolescence, si l’atmosphère du dortoir leur déplaît. Mais cet aspect de la vie en jikkenchi a naturellement exposé la communauté à des critiques très vives au fil de son histoire, qui ont entraîné la fermeture des écoles primaires qu’elle gérait autrefois. Les enfants vont désormais à l’école au-dehors du village. Une fois grands, s’ils souhaitent aller à l’université, les onéreux frais de scolarité seront pris en charge par l’Association.
Une fois atteint l’âge de 18 ans, même un jeune ayant passé toute son enfance au sein de la communauté devra prendre activement et de lui-même la décision de devenir membre ; auquel cas il lui faudra participer… au Tokkoh. Sans surprise, nombre de ces jeunes gens préfèrent quitter la communauté pour aller faire leurs armes ailleurs – avant de revenir, bien souvent : ces « enfants du village » représentent aujourd’hui la majorité des nouveaux membres rejoignant l’Association.
YAMAGISHI DANS LE MONDE
Le mouvement a beau ne pas être particulièrement prosélyte, il a déjà essaimé dans divers endroits du monde. Des jikkenchi de taille assez réduite existent à présent en Corée du sud, en Thailande, en Australie, en Suisse et au Brésil – et bientôt peut-être, en Mongolie et à Taïwan. Si en Thailande et en Australie leurs membres sont prédominément d’origine japonaise, ailleurs il rassemblent surtout des gens du cru.
Cela semble contredire ceux qui estiment ce mode d’organisation sociale uniquement adapté au socle culturel japonais ou asiatique. E. Callenbach, par exemple, admiratif de ce mouvement « qui démontre qu’un ordre social égalitaire, séculier et démocratique est possible, et soutenable écologiquement, » est convaincu de cette exception culturelle ; selon lui, le « substrat coopératif » nippon rend acceptable cette vie en collectivité, au contraire de l’individualisme occidental exacerbé par les forces du néo-libéralisme.
Rita, Japonaise d’adoption, voit cependant les choses sous un angle différent. « Ce qui rend possible la vie en jikkenchi, c’est le kensan, c’est-à-dire la volonté d’écouter réellement – à la fois les gens qui nous entourent, et soi-même. Certes, contrairement à un Européen, un Japonais ordinaire donnera souvent l’impression de chercher la conciliation et le compromis en toute situation ; mais ce ne sera en général qu’un accord superficiel, allant à l’encontre des sentiments personnels profonds. Pour vivre ensemble comme nous le faisons, nous devons parvenir à une entente mutuelle et à une compréhension personnelle d’une réelle profondeur, ce qui est tout aussi difficile pour des Japonais que pour des Occidentaux. Nous autres Européens avons beau être le plus souvent encouragés à nous exprimer de façon directe, être clairement au fait de ce que nous pensons en notre for intérieur reste une gageure. »
De fait, la « pensée Yamagishi » ne se résume pas au mode de vie particulier qui régit les jikkenchi, loin s’en faut. La majorité des membres de l’Association vit d’ailleurs à l’extérieur de ces villages. Selon M. Hori, chiropracteur exerçant à Kasugayama : « Personne ne peut dire que le jikkenchi, tel qu’il existe aujourd’hui, est un modèle idéal de vie en société ! Peut-être qu’un jour nous trouverons un modèle d’organisation encore meilleur. Pour l’heure, nous essayons simplement de perfectionner celui-ci du mieux que nous pouvons. Mais l’important est que nous transmettions le message d’amour et de paix qui nous unit : tant que cet esprit inspire et anime certaines personnes, y compris en-dehors de nos jikkenchi, voire en-dehors du Japon, alors nos efforts et ceux de nos prédecesseurs n’auront pas été en vain. »
L’initiation à cette philosophie, clé de voûte et raison d’être de l’Association, commence avec le séminaire du Tokkoh, auquel ont déjà participé plus de 100 000 personnes depuis la séance inaugurale de 1953. Un moment essentiel – un quasi-baptême – dans la vie de ceux qui choisiront ensuite de devenir membres, et dont le souvenir évoque sourires nostalgiques et complicité. « Tu as participé à la 1944e session ? » me demande M. Sakuramoto, mon collègue au département Légumes de Kasugayama et randonneur chevronné. « Moi, c’était la 600e ! On était 240 à y participer en même temps, en deux groupes de 120 personnes… » Inutile de préciser que les effectifs ont considérablement diminué au fil des ans : nous n’étions que neuf participants dans ma session. Cependant, ce séminaire semble aussi s’être ouvert de plus en plus aux participants étrangers – les jikkenchi dans le reste du monde peuvent aussi organiser leurs propres sessions. Une session bilingue sino-japonaise est d’ailleurs prévue au Japon pour cet été, du fait de l’intérêt de plus en plus marqué envers l’Association de la part de Chinois venus du continent, de Hong Kong et de Taïwan.
Alors, face à la diminution et au vieillissement de la population dans les villages Yamagishi dans l’archipel, le mouvement gagnera-t-il un nouveau souffle à l’étranger ? « Aucune communauté intentionnelle n’a survécu plus de trois générations au Japon, » me confie Rita. « Nous y voici. Pour nous, c’est un moment crucial. Rien n’est dit, rien n’est joué. Mais c’est justement pour cette raison que vivre ici, pour moi, est si passionnant. Je pense qu’ailleurs, je m’ennuierais. »
***
2 La communauté la plus ancienne reste Atarashiki Mura, un village établi en 1918 dans la préfecture de Saitama par l’artiste et philosophe Saneatsu Mushanokōji. Il ne rassemble aujourd’hui plus qu’une vingtaine de personnes.
3 À noter cependant que les villages importent environ 30% du fourrage utilisé dans leurs activités d’élevage.
4 E. Callenbach est notamment l’auteur du roman Ecotopia (1975), dont l’influence a été très forte au sein de la contre-culture et du mouvement écologique anglo-saxon. Voir son article « “Ecotopia” in Japan? » dans Communities No.132, automne 2006.
5 Près de 300 salariés sont employés en tout par l’Association Yamagishi, dont il ne sont pas membres.
6 Aucune vérification n’est effectuée, cependant : il s’agit d’une simple déclaration sur l’honneur. En pratique, rien n’empêche quiconque de n’apporter qu’une fraction de ses biens.
7 Cela semble cependant être une pratique plus répandue parmi les adolescents grandissant dans les villages, qui ne sont pas encore devenus membres de l’Association à part entière.
8 Extraits du livret Real State of the Yamagishi Society. How to Construct the World Revolution, qui rassemble certains discours du fondateur.
10 À ce sujet, voir par exemple « Imperfect Utopias: Green Intentional Communities » de Lucy Sargisson, Ecopolitics Online Journal, Volume 1, No. 1, hiver 2007
11 La justice japonaise ordonna dans la plupart des cas la restitution d’environ 50% de ces biens, arguant le fait que « cette pratique [allait] à l’encontre des coutumes nationales ». De nos jours, l’Association semble systématiquement opter pour une rupture à l’amiable avec les membres souhaitant regagner le monde extérieur, et leur reverser une portion conséquente des biens contribués à leur arrivée. Sur ce point, voir « Whatever Happened to Yamagishi? Idealism, Nature and the Environment in Japan’s Cooperative Agrarian Community, » par John Spiri. The Asia-Pacific Journal, Volume 6, Issue 2, Number 0, Février 2008.
12 Des efforts sont toutefois mis en œuvre pour endiguer cette tendance : le nombre des travailleurs agricoles salariés a ainsi baissé de 400 à 300 personnes ces dix dernières années.