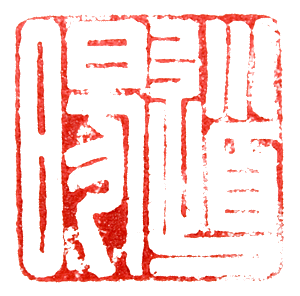Un mois dans la communauté Yamagishi (partie 1)
Lorsque j’arrive dans la salle principale où va se dérouler le Tokkoh et qu’on m’y laisse seul, j’ai beau être préparé à une expérience hors du commun, le choc visuel est tel que je reste un moment sidéré ; tout va bien, tout va bien, dois-je me répéter, tu n’es pas en danger. Ceci n’est pas une secte.
Je me trouve dans une pièce d’environ 80 mètres carrés entièrement recouverte de tatami. Située au deuxième étage du bâtiment et inondée par le clair soleil du mois de mai en cette fin de matinée, c’est un espace d’une profonde tranquillité ; on ne perçoit que la rumeur du vent dans les bois qui cernent ce petit complexe caché au fin fond de la campagne japonaise. On pourrait s’imaginer une demeure moderne et confortable, à l’intérieur arrangé dans ce souci de l’épure si caractéristique de l’esthétique nippone.
Mais dans cette pièce, pas d’alcôve sacrée où l’on aurait disposé un vase contenant quelque fleur ou rameau choisi pour sa beauté gracile, au-devant d’une austère calligraphie. Le seul mobilier est un ensemble de quatorze simples chaises en bois, disposées en cercle au milieu de la pièce. Et aux murs, pour toute décoration, une longue banderole de papier où se trouve calligraphiée noir sur blanc, en grands caractères sino-japonais d’allure sévère, l’inscription suivante : « 1944e Session spéciale de séminaire Kensan. »
En japonais, ce nom à rallonge est simplifié sous le terme « Tokkoh. » Bien qu’il s’agisse d’une simple contraction du terme tokubetsu koushuu (« séminaire spécial »), ces deux syllabes peuvent provoquer l’effroi : en effet, « tokkoh » signifiera aussi – entre autres – « Police spéciale » (équivalent nippon de la Gestapo pendant la Seconde guerre mondiale), voire même… « attaque kamikaze » ! 1
Je suis peu à peu rejoint dans la salle de réunion par cinq Japonais, et trois Chinois. Nous sommes trentenaires pour la plupart, mais l’une d’entre nous n’a que vingt-cinq ans, et le plus âgé du groupe a la soixantaine bien sonnée. Assis en cercle sur nos chaises spartiates, nous échangeons coups d’œil timides et salutations embarrassées.
C’est aujourd’hui le premier jour d’un séminaire destiné à durer une semaine. Organisé plusieurs fois l’an, le Tokkoh est une expérience d’introduction à la philosophie de l’Association Yamagishi, sans doute l’organisation communautaire et anti-matérialiste la plus remarquable de toute l’histoire du Japon. Quiconque souhaite visiter l’un des 26 villages regroupées sous cette égide, qui représentent au total près de 1250 personnes dans tout le pays, se voit encouragé à prendre d’abord part à ce séminaire. Intrigué, j’ai accepté.
Apparaissent maintenant les trois facilitateurs, Kozoh, Yuuki et Karin, et les deux traductrices, Rita et Kazuko. Kozoh, un homme d’une trentaine d’années à la mine sombre, prend la parole.
« Soyez les bienvenus. Ce Tokkoh se déroulera en japonais et en anglais, et durera une semaine entière. Vous serez impliqués vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous ensemble, jour et nuit. Il n’est possible de participer au Tokkoh qu’une seule et unique fois dans sa vie ; aussi, profitez pleinement de cette occasion.
Nous sommes tous égaux. Il n’y a ici ni professeur, ni élèves. Si d’aventure, au cours de cette semaine, vous peinez à comprendre le but de cette expérience, nous vous prions de ne pas abandonner. Accrochez-vous. Et continuez à réfléchir. Bien entendu, si vous souhaitez partir, nous ne pouvons vous retenir.
À présent, nous allons demander à chacun de nous confier toute chose dont vous n’aurez pas besoin pendant cette semaine. Ne gardez que quelques vêtements de rechange et produits de toilette, ainsi que vos médicaments si vous en prenez. Nous souhaitons tout particulièrement que vous nous remettiez vos montres, téléphones mobiles, ordinateurs, livres, magazines, et toute autre chose qui vous relierait au monde extérieur. Pour le temps de ce Tokkoh, soyez entièrement présent, à vous-même comme aux autres participants. »
Nous nous exécutons. Chacun d’entre nous est ensuite convié à signer une déclaration certifiant que nous avons dix-huit ans révolus – et ne souffrons, à notre connaissance, d’aucune maladie mentale. Enfin, après un délicieux déjeuner dans le réfectoire voisin, notre séminaire commence pour de bon.
« Je vais maintenant vous soumettre un énoncé. Ecoutez-moi bien. Réfléchissez-y chacun pour vous-mêmes, puis partagez avec nous le fruit de vos réflexions. Sommes-nous prêts ? »
Et alors, Kozoh nous pose la première question. Nous voilà lancés dans un voyage intellectuel et personnel hors du commun.
QUE DIRE ?
L’un des principaux défis rencontré par quiconque souhaite partager avec autrui le contenu du Tokkoh peut s’apparenter, prosaïquement, à celui du critique de littérature ou de cinéma anxieux de ne pas gâcher le plaisir de ses lecteurs : en dire trop serait les priver du sel de la découverte, et donc distordre de manière indésirable leur perception de l’œuvre ; mais en dire trop peu serait risquer de diminuer la raison d’être de l’article même, voire donner une fausse idée de l’objet discuté. Tentons d’éviter l’un comme l’autre de ces écueils.
La forme du Tokkoh est plutôt facile à expliquer : il s’agit de réfléchir, de la manière la plus approfondie possible, à une série de questions énoncées par les facilitateurs. Chacun des participants est invité à méditer sur chacune d’elles, et à faire part au groupe de ses pensées, de façon sincère et courtoise, en évitant autant que possible les jugements de valeur à l’encontre d’autrui. Les facilitateurs eux-mêmes n’émettent aucun commentaire sur les réponses. La question est répétée, à intervalles réguliers, par l’un ou l’autre des organisateurs. Et l’on rumine à ce sujet pendant une durée qui peut s’étaler de quelques heures à peine, jusqu’à bien plus longtemps : au cours de notre session, nous réfléchissons à l’un de ces énoncés près de deux jours entiers.
Présenter les questions posées, en revanche, est une affaire bien plus corsée. En effet, celles-ci sont en apparence fort simples, et il semble souvent naturel d’y répondre de façon directe et sans ambages. Cependant, le simple fait de se concentrer – de façon à la fois personnelle et collective – sur chacune d’elles pendant de nombreuses heures d’affilée fera souvent surgir des aspects nouveaux et fascinants du problème, qu’une réflexion passagère et individuelle n’aurait peut-être pas révélé. En ce sens, on peut comprendre le Tokkoh avant tout comme un exercice philosophique et poétique visant à faire affluer la sagesse née de l’expérience de chacun des participants autour de thèmes universels, par l’articulation, la juxtaposition ou le prolongement d’interprétations aussi diverses que possibles : les organisateurs nous encouragent en effet à « attaquer » toute question depuis autant de différents angles que possible.
C’est à n’en pas douter une expérience profondément immersive ; dès les premiers jours, l’encouragement initial de Kozoh nous exhortant à ne pas jeter l’éponge acquiert tout son sens. Car si la répétition ad nauseam d’un même énoncé peut donner lieu à une sensation d’étouffement, d’impatience, et même d’antipathie à l’égard des facilitateurs – « Mais bon sang, qu’est-ce qu’ils cherchent donc à entendre ?! » – l’un des aspects primordiaux de cette contemplation consiste à réaliser qu’il n’y a ni « bonne » ni « mauvaise » réponse. Le but fondamental du Tokkoh, en ce sens, est de « creuser » ces questions de plus en plus profondément, avec l’aide d’autrui, dans l’espoir de toucher à une vision la plus objective possible du monde, des autres, et de soi-même.
Cette quête d’objectivité maximale pourrait être considérée comme une fin en soi, tant il est notoirement difficile – et sans doute impossible – d’échapper tout à fait aux limitations de notre subjectivité : j’aurai beau tenter d’ouvrir les « portes de la perception » évoquées par William Blake, le monde que je perçois m’apparaîtra toujours, bien entendu, filtré au travers des mailles de mon expérience et de la conscience par elle façonnée.
Mais les supports de cette réflexion, on s’en doute, ne sont pas choisis au hasard. De fait, les questions qui nous sont soumises évoquent indirectement l’objectif officiel de l’Association Yamagishi : « Promouvoir l’harmonie entre la nature et les activités humaines, et apporter à l’humanité une société stable et confortable emplie d’abondance, de santé, et d’affection. » Quant à la forme du Tokkoh, elle est l’expression directe du credo déclaré de l’Association, à savoir : « Examinons si nos pensées et nos actions contribueront réellement à la prospérité et au bonheur éternels de la société (y compris soi-même), et souvenons-nous de ne pas nous attacher trop fortement aux résultats immédiats (valables uniquement pour notre génération et notre environnement proche). » 2
En somme, le Tokkoh est à la fois un exercice de réflexion approfondie, et une introduction à la pensée qui sous-tend la communauté Yamagishi – une philosophie qui fait la part belle à la décision et à la satisfaction collectives, et à l’harmonie entre l’homme et le reste du monde vivant. Les questions qu’on y examine visent à faire sortir des sentiers battus de la pensée, et à (re-)découvrir certaines vérités qu’on peut avoir tendance à négliger, lorsqu’on est pris comme tout un chacun dans le tourbillon de la vie quotidienne.
UNE NOUVELLE FAMILLE
Mais plus encore, ce séminaire est aussi une expérience radicale de vie en société. Comme on nous l’a fait savoir d’emblée, l’intégralité du Tokkoh s’effectue en compagnie des autres participants. Ils sont mes uniques interlocuteurs lors des trois longues sessions de méditation qui rythment notre journée sans horloges ni téléphones mobiles ; j’ai leur conversation pour seule distraction pendant nos « pauses thé » (le café, trop excitant, est prohibé) ; c’est à la même grande table que nous prenons nos repas – qui s’avèrent copieux et succulents, et dont les ingrédients proviennent quasi-intégralement de communautés Yamagishi. La vaisselle, cela va de soi, se fait elle aussi en groupe.
Certains aspects de cette vie collective ont une saveur indéniablement japonaise : le soir, nous prenons notre bain ensemble dans deux grandes salles de bain, une pour chaque sexe ; puis nous rangeons les chaises de notre pièce de réflexion, et préparons tous ensemble les futon sur lesquels nous allons dormir dans ce même lieu, hommes d’un côté et femmes de l’autre. Mais l’heure pour moi la plus amusante – et la plus irréelle – est celle du réveil : tirés du sommeil par Kozoh, nous sommes conduits en pyjama dans le jardin au pied du bâtiment, et comme les premiers rayons du soleil levant caressent les bambous bruissants autour de nous, une cassette audio est placée dans un vénérable poste à musique. Tout bâillants, les yeux bouffis et les cheveux en pétard, nous exécutons des mouvements de gymnastique suédoise – « On lève les bras ! … Rotation des hanches ! … Sautillements sur un pied ! … » – au rythme d’une chanson en japonais scandée à tue-tête par un pianiste forcené : « Un nouveau matin est arrivé, un matin plein d’espoir / Et nos cœurs s’ouvrent à la joie… »
La première fois, je suis le plus ahuri du groupe : les Japonais parmi nous ont vécu presque tous les matins de leur enfance au son de cette chanson qu’ils fredonnent avec un plaisir nostalgique, et au rythme de ces exercices dont ils connaissent les gestes par cœur.3 Quant à nos amis chinois, ils se sont eux aussi éveillés pendant longtemps au son de leur version nationale de ce rituel, destiné à accélérer la circulation sanguine et à faciliter la sortie d’entre les limbes du sommeil ; et force est de reconnaître sa redoutable efficacité !
Ce n’est qu’après avoir soigneusement nettoyé, tous ensemble, notre espace à vivre – salle de séminaire, toilettes et salles de bain – que nous pouvons enfin procéder à nos ablutions matinales et nous habiller ; manière, sans doute, de souligner une nouvelle fois la primauté de l’espace collectif – concret comme figuré – sur l’individu.
Il va sans dire que cette présence permanente d’autrui peut s’avérer oppressante, en particulier pour quiconque chérit l’espace à soi. Le seul moment où je parviens à chiper quelques miettes de solitude est à mon retour du bain vespéral ; avant que ne soit donné le signal du dîner, il m’est possible de m’asseoir quelques minutes au pied d’un arbre pour contempler le soleil couchant, et rêver à des balades dans la forêt environnante. Le manque d’exercice physique se fait ressentir au bout de quelques jours, et je peine parfois à trouver le sommeil.
Mais la socialisation forcée permet aussi de tisser des liens d’une grande solidité. De méditations existentielles en conversations de salle de bain, malgré les barrières de la langue, on ne peut qu’être frappé par la surprenante variété des personnalités de ceux qui nous entourent, en même temps que par notre indéniable unicité humaine, qu’importent nos différences de parcours ou d’opinions : qu’il s’agisse de M., ce chef d’entreprise irascible et à l’humour ravageur, aux relations familiales conflictuelles ; N., installateur de panneaux photovoltaïques, père de trois enfants et guitariste chevronné au sein d’un groupe de blues ; ou encore O., lutteur de sumo professionnel pendant dix ans, reconverti dans l’agriculture bio – ces gens qui m’entourent en viennent peu à peu à acquérir une densité, une vérité toute particulière. Les yeux fermés, assis sur ma chaise dans notre salle de réflexion où seule la lente trajectoire des ombres trahit le passage du temps, je peux identifier la voix de chacun et imaginer l’expression exacte de son visage comme il prend la parole. Chacun d’entre eux m’a déjà tant confié qu’une image, une tonalité, une forme très claire se dessinent en moi à la simple évocation de leurs noms.
L’espace d’une semaine, ces huit personnes qui m’entourent en viendront à former une nouvelle famille, une famille intentionnelle. A l’heure de la séparation, comme se termine cette cohabitation si soudaine, si brève mais si riche, les voix s’étranglent, les yeux s’embuent. Nous retournons chacun à nos affaires, à nos familles, à nos vies, mais on peut dire sans trop exagérer qu’un sentiment de réelle fraternité est né. Saura-t-on le faire perdurer ?
C’est bien sûr là un autre but fondamental du Tokkoh : nous donner un aperçu, en version concentrée, de ce à quoi peut ressembler la vie dans une communauté Yamagishi. Le séminaire terminé, marqué par cette expérience très forte, c’est donc avec une curiosité renouvelée que je gagne Kasugayama, la toute première commune de ce type, créée en 1958. Comment la philosophie Yamagishi s’intègre-t-elle au monde réel et à la vie quotidienne ?
À SUIVRE…
1 À noter qu’il ne s’agit là que d’homophones, dont la langue japonaise est particulièrement riche : toute confusion entre ces différents termes disparaît sitôt qu’ils se trouvent écrits à l’aide des caractères sino-japonais (kanji) correspondants.
2 Extraits du livret Real State of the Yamagishi Society. How to Construct the World Revolution, édité par l’Association.
3 Voir un exemple ici : https://www.youtube.com/watch?v=xS92XkVKM0Q