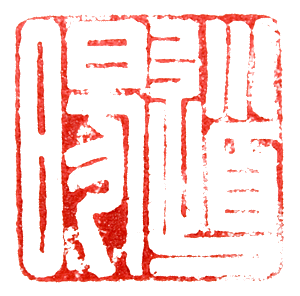4 – Les collègues
Cette première semaine, je suis assis entre Jim et Laura. Jim est un petit homme approchant la quarantaine, portant des lunettes, au caractère paisible, effacé au possible. Il s’exprime dans un anglais timide et balbutiant. Sur la plaque qui orne son bureau, il est écrit :
LI JUN (Jim) – Devise : « Prendre la vie comme elle vient. »
Loisir : Badminton.
Jim est le manager de ce département, mais il ne dispose que d’un petit cubicle en tout point semblable à ceux des employés qu’il supervise.
Laura, trentenaire, est elle aussi très réservée. À ses manières timides, son physique assez ingrat, et ses nombreuses heures supplémentaires au bureau chaque jour, on devine qu’elle est une sheng nü – c’est-à-dire une jeune femme bien éduquée, en pleine ascension professionnelle, qui commence à dépasser l’âge limite socialement accepté pour le mariage – situation cauchemardesque pour une chinoise ; littéralement, cette expression familière signifie « une femme qui reste » ou « un reste de femme », comme on parlerait d’un reste du poulet de la veille. Elle aussi, parfois, relit les traductions d’autrui. Son anglais n’est pas splendide, loin de là, mais elle excelle dans la maîtrise du vocabulaire de comptabilité sino-anglais – ce qui est une horrible tare, ne nous voilons pas la face. Sur la plaque de son bureau :
AI HUA (Laura). Devise : « Sincérité, travail, discipline. »
Loisir : __________
Mon bureau est quant à lui décoré d’un écriteau en anglais :
LU KEFEI (C. Vali R.). « Always beware of any helpful machinery that weighs less than its operation manual. »
La présence de cette plaque ici est un mystère, étant donné que son propriétaire – le dénommé Vali – demeure toujours assis à l’autre bout du bureau. C’est une espèce de colosse blond à petite barbiche, qui s’exprime dans un accent anglo-écossais à couper au couteau. En présence de ses collègues chinois, il se montre impatient, brusque, comme s’il avait toujours bien mieux à faire que de parler à ces gens ; quand je le croise dans le couloir, il marche en regardant ses chaussures, secouant la tête d’un air tourmenté, émettant des borborygmes indistincts et plaintifs qui évoquent le canidé souffrant.
Peu à peu, j’ai l’occasion de me familiariser davantage avec l’auteur de cette plaque personnelle parée d’un si flamboyant exemple d’humour d’ingénieur. En effet, on m’assoit auprès de lui pour travailler à la seule activité dont le quotient d’ennui soit à même de dépasser celui de la traduction des interfaces de logiciels de YY : il s’agit, bien sûr, du test des logiciels en question, afin de s’assurer que leurs utilisateurs anglophones ne fussent atteints d’une rupture d’anévrisme immédiate (ou du moins, que cela ne soit pas dû à la traduction des logiciels mais, par exemple, à leur ergonomie détestable).
Sans surprise, j’apprends que Vali est ingénieur. Il vit et travaille en Chine depuis de nombreuses années ; chez YY, il chapeaute le processus de vérification des traductions, et ce depuis neuf mois (durée horrifiante). Son sujet de conversation favoris est « à quel point la langue anglaise est massacrée ici-bas », et il ne perd jamais une occasion de se gausser bruyamment des erreurs commises par ses collègues chinois, erreurs qu’il répète à voix haute (nous travaillons dans de grands bureaux à cubicles, de sorte que tout le monde entend ce qu’il clame à tue-tête). Mais sans doute serais-je bien pire que lui après avoir passé neuf mois (neuf mois !) à vérifier les traductions des logiciels de YY.
Mon principal sujet d’inconfort en sa présence, cependant, est le fait qu’on m’ait recruté en tant que native English speaker. Je peux encore faire illusion auprès de la plupart de mes collègues chinois, moyennant l’exhibition de mon passeport britannique, et la production d’un gloubi-boulga de vrais-faux accents anglais libéralement inspirés de quelques souvenirs de séries TV ; mais sitôt confronté à un véritable indigène, je me sens sur-le-champ coiffé d’un béret basque, une baguette de pain sous le bras, m’empiffrant de cuisses de grenouilles.
Et cette fois-ci, je n’y coupe pas non plus. Malgré mon mutisme, et tous mes efforts de dissimulation, Vali – drapé si tranquillement, et avec tant de suffisance, dans cet accent authentique que j’épie avec haine et envie, que je lui arracherais volontiers un soir au coin d’une ruelle sombre –, Vali ne tarde pas à m’interroger : « So, you’re a French-British… How does that work? »
Je m’en tire avec une réponse évasive et peu convaincante, selon laquelle j’aurais grandi « entre les deux pays » ; mais rien à faire, survient l’écrasante sensation d’avoir vu mon déguisement percé à jour. Et si Vali allait parler à Jim le manager, et lui révéler que mon accent est tout de même bien plus français que britannique ?
C’est en partie du fait de cette sorte de malaise identitaire, en partie pour la nausée irrésistible qui me saisit à l’usage des logiciels de YY… et, surtout, à cause du lever matinal à 6h30, que j’ai décidé de travailler uniquement depuis chez moi à l’avenir.
Cela ne réjouit pas outre mesure la responsable du pôle des Ressources humaines, désormais en demeure de poster de nouvelles petites annonces sur Internet. Apprenant que mon objection principale tient à la distance du lieu de travail depuis chez moi, elle essaie de me convaincre, le plus sérieusement du monde, de déménager, et venir vivre quelque part à proximité du bureau. Je me retiens tout juste de lui rire méchamment au nez.
Jim le manager, lui, tente une autre approche, elle aussi très chinoise. « On peut te donner 100 kuai par jour, en tant que frais de taxi. Que tu peux empocher, même si tu préfères continuer à prendre le bus. » 100 kuai par jour, c’est une belle augmentation. Mais même si l’usage d’un taxi était à même de me faire changer d’avis, cette augmentation suffirait à peine à payer un aller simple depuis chez moi jusqu’à l’entreprise… Mon sommeil ne se monnaye pas à si vil prix.
« 3 – Le travail • 5 – Le retour »