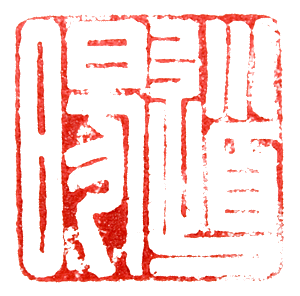1 – Le matin
Mon réveil sonne à 6h30. Aussitôt, je me projette hors du lit, mû par une sorte de sursaut animal ; je trébuche, boitille, et m’emmêle dans les gracieux rideaux de perles métalliques entourant la couche. Ceux qui me connaissent bien remarqueront que je ne m’administre pas même les Deux Minutes de Sommeil Supplémentaires qui sont normalement mon dû, et qui ont cette faculté de se transformer invariablement en deux ou trois heures de retard. Lorsque l’on travaille pour YY, c’est l’un des menus privilèges auxquels il faut renoncer : l’exploitation commence dès le saut du lit.
Hébété, sans avoir encore gagné le plein contrôle de mes facultés sensorielles ou motrices, je parviens à trouver le chemin de la douche, ouvre l’unique robinet, mais demeure au sec le temps que l’eau chauffe, me souviens finalement qu’il faut d’abord allumer le chauffe-eau dans la cuisine, lutte avec ledit chauffe-eau qui est une machine diabolique conçue par des pervers sadiques et s’obstine à ne fournir, comme seule alternative à l’eau glaciale, qu’un geyser de matière volcanique en fusion, et après avoir tripoté en vain les boutons du chauffe-eau pendant quelques minutes je maudis l’engin et toute sa chaîne de production dégénérée, et me résigne à une douche froide, qui a au moins le mérite de me réveiller quelque peu. J’enfile un t-shirt au hasard et un pantalon moins troué que les autres, et me précipite au-dehors.
Il n’est pas encore 7h mais les rues du quartier de Sanlitun s’animent déjà. Taxis klaxonnants, mototaxis à trois roues et leurs cabines de fer blanc bringuebalantes, grands-mères hardies arpentant la rue à reculons en frappant dans leurs mains, l’air grave et impassible (c’est excellent pour la santé, comme chacun sait). Sur mon vieux vélo de course au pédalier grinçant, je me faufile au milieu de la circulation, tâchant d’allier vitesse et survie. Le bus n’est qu’à une dizaine de minutes de là, mais il s’agit de ne pas le manquer en se faisant bêtement écraser.
J’attache ma monture dans le grand parking à vélos situé près de la sortie nord de la station de métro Agricultural Exhibition Center. Les feux rouges ont été cléments, je dispose de quelques minutes d’avance. J’achète une crêpe aux œufs garnie de salade et d’une viande grillée inconnue auprès du stand mobile de petit déjeuner qui surgit en ces lieux tous les matins – mari et femme, tabliers salis, joues rouges et manières d’habitants de la campagne, accent pittoresque. Le matin est doux, le ciel azur, le soleil caresse de rayons dorés les vélos les arbres et le flot des voitures qui bouchonnent déjà sur le troisième périphérique.
Le grand bus blanc est l’un des cinquante de son genre spécialement affrétés par YY pour assurer le transport de ses employés ; chacun d’eux part d’un endroit spécifique de Pékin, et suit un parcours qui lui est propre. Celui-ci commence sa route près du parking à vélos.
J’y grimpe avec ma crêpe. Une poignée de collègues inconnus ont déjà pris place. Derrière le volant, le chauffeur Ma m’ignore superbement ; il est épais, bedonnant, le visage maussade et carré d’un Chinois du nord-est. Je ne le salue pas non plus.
Lundi matin, mon premier jour, comme j’entreprenais de monter à bord vêtu de mon plus beau costume-cravate – c’est-à-dire, mon unique costume-cravate, qui me fait les épaules carrées et les jambes maigres – le chauffeur Ma n’en a pas cru ses yeux ; sous prétexte que je n’avais pas la carte de transport de l’entreprise, il m’a bouté hors du bus avec le fanatisme impitoyable de ceux qui rencontrent quelque difficulté le matin avant d’être bien réveillés (ce dont mon chauffe-eau a souvent fait l’expérience).
Pendant les deux jours suivants, après mon obtention de la carte en question, j’ai eu droit de la part du chauffeur Ma à un traitement de faveur – grognements de bonjour et d’au-revoir, quelques hochements de tête, sans doute pour se faire pardonner son intransigeance. Mais par la suite, ma présence se répétant jour après jour (sans plus de costume-cravate), le chauffeur Ma a cessé de me prêter attention ; je suis devenu partie de sa routine. Et surtout, un laowai [1] pas même capable de se payer sa propre voiture pour aller au travail est-il digne du moindre respect ?
À 7h05, nous partons.
Au gré des arrêts, le bus se remplit peu à peu d’autres employés de YY, jusqu’à être complètement bondé. Travailleurs et travailleuses ont l’apparence jeune, malingre et docile de xiao bailing [2] sous-payés. Nul ne souffle mot ; beaucoup poursuivent leur nuit sur les sièges propres mais étriqués du bus, qu’on ne peut incliner sans broyer les rotules du passager derrière soi. Le bus me semble un grand tombeau roulant, dont le silence n’est troublé que par le souffle lourd de la climatisation, et les coups de klaxons maussades du chauffeur Ma.
Le trajet est long de 35 kilomètres ; nous le parcourons chaque matin en une heure et vingt minutes. J’irais aussi vite à vélo, si d’aventure j’étais assez fatigué de vivre pour vouloir pédaler trois heures par jour dans ces artères bouchonnées, saturées de hargne automobile et de monoxyde de carbone.
Partis du centre-est de la ville, près du parc de Chaoyang, nous nous rendons dans la grande banlieue nord-ouest, en rase campagne. Traversée intégrale de Pékin.
Je hais cordialement et les levers matinaux, et les longs trajets en bus. Mais je n’ai guère le choix : l’alternative indépendante, via métro et bus, est encore plus désagréable. Et à tout le moins, ce temps de trajet me permet d’écouter enfin les podcasts en chinois auxquels je m’étais toujours promis de prêter une oreille attentive ; j’enrichis donc mon vocabulaire d’expressions utiles :
« Ce sont des canailles sans scrupule, et je les méprise » ;
« Conclure une union matrimoniale avec une tribu nomade pour s’assurer de son amitié » ;
« Immigration d’investissement » ;
« Jouer avec de la pâte à modeler » ;
et ce matin :
« Plus nombreux que les poils d’une vache. »
Enfin, nous quittons l’autoroute Jing-Zang, qui mène tout droit vers les hauts-lieux du tourisme de masse de la Grande Muraille. Nous sommes cernés de bâtiments trapus et négligés, dont aucun n’est haut de plus de trois étages ; traversons quelques villages décrépits, dont toute l’activité économique semble se résumer au recyclage de cartons et de matières plastiques ; et bientôt, alors que non loin de là se dessinent les Collines parfumées, couronnées d’une petite pagode écarlate, nous atteignons le YY Software Park.
YY est l’une des plus grandes compagnies de logiciels de Pékin. Elle est spécialisée dans la conception de programmes ERM, c’est-à-dire de gestion d’entreprise. Son nom, tel qu’écrit en chinois, peut se lire tantôt comme une version de l’anglais user-friendly, tantôt comme « faire usage de ses amis ».
Nous nous trouvons dans cette vaste zone péri-urbaine qui a reçu le sobriquet de « Chinese Silicon Valley ». Comme on pourrait s’y attendre, la grande majorité des firmes implantées là appartiennent au secteur de l’informatique et des nouvelles technologies. Cependant, au contraire de sa prestigieuse homonyme californienne, l’innovation caractéristique de cette Silicon Valley réside principalement dans la découverte de nouvelles manières de copier la technologie inventée ailleurs dans le monde, plus rapidement et mieux que les collègues de l’entreprise d’à-côté.[3]
Le YY Software Park est un groupe de bâtiments modernes et tous rigoureusement semblables, brique grise et grandes baies vitrées, reliés les uns aux autres par des passages incompréhensibles et labyrinthiques. Au-dedans, les bureaux se déclinent en une infinie succession d’espaces de travail équipés de petits ordinateurs noirs, derrière lesquels sont assis des multitudes d’informaticiens chétifs et fatigués. Mes déplacements solitaires m’évoquent souvent le Brazil de Terry Gilliam, ou encore le château kafkaïen ; je me perds régulièrement dans les couloirs, ne parvenant pas à retenir le numéro à neuf chiffres désignant l’espace de travail qu’on m’a assigné. Une porte sur deux ne s’ouvre que par le biais d’un passe magnétique qu’on refuse de me confier, ce qui n’arrange pas les choses.
En extérieur, l’architecture du lieu aurait toutefois pu être pire. Plusieurs passerelles entre les bureaux sont aménagées à la manière de terrasses en plein air, avec planchers, tables et chaises depuis lesquelles on peut contempler la végétation du parc – ce qui fait ressentir d’autant plus cruellement l’absence du moindre verre de pastis dans les environs. Aussi loin que porte le regard, tout n’est que pelouses, arbres et buissons divers, étang artificiel à la chinoise traversé de petits ponts de bois. On ne manque ni de verdure, ni d’oxygène. Le printemps est doux, et le vent a chassé la pollution la plus visible vers le sud.
On se prend à songer avec respect aux efforts massifs de plantation d’arbres au nord de la capitale, qui perdurent depuis de nombreuses années, et grâce auxquels la ville échappe désormais presque complètement au fléau de cette saison – les terribles tempêtes de sable venues du désert de Gobi. Puis on se rappelle que cette muraille arboricole est plantée par des gens à peu près aussi démunis que ceux ayant bâti sa cousine de pierre et de terre battue, au sommet des collines voisines, au fil de siècles et de siècles de labeur d’esclave.
Je prends mon petit déjeuner dans l’une des deux vastes cantines aménagées au rez-de-chaussée. Elles sont englouties aux heures stratégiques dans des foules compactes et affamées, issues des 5000 personnes travaillant pour YY sur ce site. Nous nous précipitons de-ci, de-là, munis de nos plateaux, baguettes et cuillers, dans un chaos indescriptible, régi par l’un des instincts fondamentaux régissant la vie en Chine continentale : « Vite, il m’en faut, avant que les autres aient tout pris ! » C’est un principe que l’on retrouve à l’œuvre dans de nombreux situations courantes – prenant le bus ou le métro (« Vite, toutes les places vont être prises ! »), mariage des jeunes femmes (« Ma fille, je vais te trouver un mari cette année, sinon tu resteras seule toute ta vie ! »), etc.
Et de fait, il suffit d’arriver au réfectoire une simple demi-heure après l’heure de pointe, et d’avoir à se rabattre sur quelques piteux restes de choux, pour comprendre le bien-fondé de cette logique.
Mais supposons que l’on se présente suffisamment tôt, comme moi ce matin. La chère est goûteuse et variée ; je dévore une « cervelle de tofu » avec quelques beignets et autres raviolis, accompagnés d’un jus d’orange et d’un lait de soja. Puis, je rejoins mon bureau – essayant d’emprunter un nouveau chemin, dans l’espoir de trouver enfin le trajet qui n’exigera pas de moi un passe magnétique. C’est un échec cuisant, bien sûr, et je me perds de nouveau.
Je ne suis employé qu’à mi-temps, raison pour laquelle on me refuse le privilège du passe magnétique. J’eus pu accepter l’offre initiale de Jim, le manager, qui me proposait de travailler pour YY à plein temps ; j’y eus gagné un emploi stable, un salaire confortable, un visa de travail, et même le très convoité passe magnétique. Mais décidant que j’avais autre chose à faire de ma vie que de traduire des logiciels de comptabilité, je préférai opter pour un emploi en télétravail après la fin de cette première semaine d’entraînement.
[1] Étranger blanc.
[2] Jeunes cols blancs.
[3] Ce qui peut paraître un cliché, mais les experts chinois eux-mêmes le reconnaissent. Voir, par exemple, cet entretien avec le professeur Cheng Xiaonong (en chinois) : http://my1510.cn/article.php?id=79169