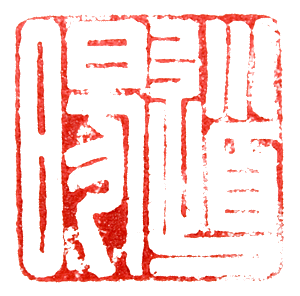5 – Le retour
17h. Je plie bagage et gagne le bus sans trop perdre de temps – comme le dit Laura : « Vite, il n’y a pas assez de place pour tout le monde dans le tien ! »
Pendant le long trajet de retour, presque tout le monde dort, moi y compris. Le bus me semble un grand tombeau roulant, dont le silence n’est troublé que par le souffle lourd de la climatisation, et les coups de klaxon maussades du chauffeur Ma.
La route est interminable, surtout les jours de sévère pollution, qui se multiplient avec l’arrivée de l’été. Notre parcours n’est qu’un long embouteillage gris et toxique, dans le flot des dizaines de milliers de gens rentrant chez eux péniblement après une pénible journée de travail. Visages ternes, regards fatigués perdus dans le vide au-travers des fenêtres de multitudes de bus et de voitures.
Le bus effectue quatre brefs arrêts sur son parcours. Le mien est le dernier. Après le troisième, à San Yuan Qiao, nous ne sommes plus qu’une poignée d’employés dans le véhicule ; sitôt la porte fermée, le chauffeur Ma tourne le bouton de son autoradio d’un geste sec et irrité, et notre bus est envahi à plein volume par le Bruit.
C’est le moment que le chauffeur Ma attend avec le plus d’impatience chaque jour, j’en mettrais ma main au feu. Son raisonnement ne pourrait être plus clair : passé le troisième arrêt, nous autres passagers sommes désormais trop peu nombreux pour que quiconque ose élever la moindre protestation à propos du Bruit – si tant est qu’on puisse imaginer protestation autre que discrète et timide venant d’informaticiens malingres et exploités, dont le chauffeur Ma ne ferait qu’une bouchée.
Une autre hypothèse serait que le chauffeur Ma n’a plus de scrupules à nous infliger le Bruit, à présent que nous sommes réduits à un groupe insignifiant. Après tout, une minorité souffre toujours en toute circonstance, comme le souligne la millénaire sagesse chinoise.
Parfois, le Bruit se manifeste sous la forme de chansons romantiques sirupeuses, de celles qui font regretter d’avoir des tympans – jusqu’au jour heureux où elles les crèvent ; de celles qui incarnent et précipitent à elles seules la gangrène esthétique du pays tout entier. Parfois, le Bruit provient d’une compilation qui pourrait s’intituler Les Plus Grands Succès de la Techno Des Années ’80, et qui me rappelle la toute première K7 audio qu’on m’ait offert, il y a peut-être vingt ans de cela. Une musique de synthétiseurs criards et sautillants. J’en pleurerais de nostalgie. Et puis non, c’est trop infâme.
Peut-être vaut-il encore mieux que le chauffeur Ma et moi ayons rompu le dialogue : toute relation cordiale entre nous était de toute façon vouée à l’échec. Il y a des fautes de goût qu’on ne peut pardonner.
Quinze minutes plus tard, abrutis par le Bruit, les trois ou quatre passagers qui restent et moi-même titubons hors du bus. Le chauffeur Ma ne nous jette pas même un regard ; il fixe le troisième périphérique d’un air buté, plongé dans son vacarme infernal.
Dans la brise claire et chaude de la fin d’après-midi, comme les derniers rayons du soleil se brisent contre la tour Citic Bank, au cœur du quartier des ambassades, je regagne le parking à vélos. En sortant, je tends un billet violet de 5 mao à la gardienne. C’est une jeune femme rougeaude qui loge dans la petite cabine à la sortie du parking, une cabine décorée de rideaux à fleurs et à petits lapins tout juste assez spacieuse pour contenir un petit lit, et un meuble avec une télé branchée en permanence sur les infos de CCTV, la chaîne de télévision nationale.
La gardienne est assise là sur un tablier pliant, souriante et paisible, bavardant avec une amie dans un dialecte du sud auquel je ne comprends goutte ; elles jouent avec son bébé, un gros nourrisson costaud et basané au regard brillant et au sourire féroce, dont les rugissements impérieux et puissants laissent transparaître la plus totale confiance en son droit naturel à dominer un jour le monde.
Le vent du soir bruisse dans les feuilles des grands peupliers de l’avenue Dongzhimen Wai, comme je lui fais la course le long des voies de vélo larges et désertes. Au croisement avec Sanlitun Lu, un homme à sacoche d’allure respectable se précipite de gauche à droite, hélant et gueulant à toute force après des taxis vides qui l’ignorent superbement, comme c’est d’usage dans ce quartier.
Au feu vert, une patrouille de la force armée de protection diplomatique traverse l’avenue au pas, digne et synchronisée ; ce sont les soldats qui montent la garde aux portes des ambassades – jeunes, droits dans leurs bottes, clonés. Ils sont précédés d’un sous-officier brandissant un panonceau orné de lampes vertes et rouges, qui sert à prier les automobilistes de ne pas écraser la patrouille pendant qu’elle traverse sur le passage clouté.
Sanlitun Lu est l’une des rues de beuverie et de fête les plus connues de la ville ; la soirée commence à peine, mais le cycliste se doit déjà de prendre garde à ne point trop se laisser distraire par le ballet des minijupes et autres shorts moulants, qui abondent, sous peine d’être renversé et annihilé par l’un des mototaxis – au siège arrière marqué de grandes publicités MASSAGE, en anglais ou en russe – qui s’engouffrent dans la rue étroite comme les hordes de Gengis Khan envahirent en leur temps les plaines de la Transoxiane.
Avant de monter chez moi, j’avale un petit encas dans l’échoppe au bas de l’immeuble : une « peau froide » – plat de délicieuses nouilles au concombre, a la sauce de sésame et à l’ail, qui se dégustent surtout pendant la saison chaude, avec un peu de piment. J’accompagne cela d’une bière Yanjing (bière de Pékin, la moins chère de toutes) ; sur le goulot, je lis que « la bière Yanjing est partenaire officielle du programme spatial lunaire chinois. »
Il est 19h, plus de douze heures après mon départ de chez moi. L’heure de retourner à l’essentiel.
« 4 – Les collègues • Bouhinque »